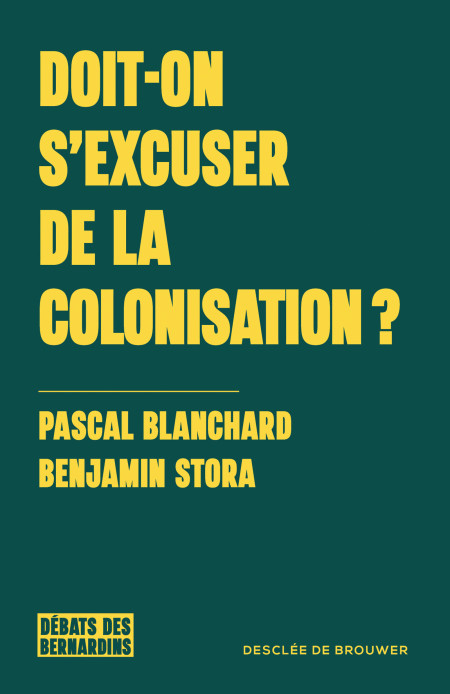
Doit-on s’excuser de la colonisation ?
Publication en août 2025
160 pages
13,90 Euros
Infos & réservation
Thème
« Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Je répète qu’il y a, pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ».
Cette phrase, qu’un « digne » représentant de l’extrême-droite française actuelle ne pourrait pas même prononcer, même s’il la « pense » secrètement, sans être à juste titre condamné devant les tribunaux, est extraite d’un discours prononcé à l’Assemblée nationale le 28 juillet 1888 par Jules Ferry, le chantre de la gauche républicaine.
Nos auteurs eussent pu tout aussi bien, leur noble corporation eût-elle dû en souffrir, citer l’historien Renan qui dans La réforme intellectuelle et morale affirmait sans barguigner « La régénération des races inférieures et abâtardies par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité ».
Dans ce livre d’entretiens, les historiens Pascal Blanchard et Benjamin Stora affirment avec force une thèse à méditer. L’entreprise de la colonisation qui ne cesse de hanter la mémoire nationale, vieille de plus de cinq siècles d’histoire, n’était pas sous la Troisième République, de la fin du XIXème siècle jusqu’au tournant des Années Trente qui marqua son apogée avec cette France aux cent millions d’âmes, une question périphérique qui eût seulement concernée ceux de “là-bas”, mais est bel et bien une question centrale impulsée “d’ici”, au cœur de la métropole.
Elle est restée longtemps consensuelle. Légitimée qu’elle était en ce temps-là, par le discours historique, revendiquée par les politiques de tous bords, sanctionnée par le droit, relayée par les manuels scolaires et la propagande, avant que la guerre mémorielle entre nation colonisatrice et peuples colonisés, qui fit suite aux mouvements de décolonisation, ne fasse rage et que la mémoire collective nationale ne se fracture.
Les temps actuels sont, au contraire, caractérisés par les thèmes récurrents de la repentance, à l’instar de ce jeune président français qui a affirmé, peut-être hâtivement, que la guerre d’Algérie relevait de la catégorie des crimes de guerre. Quoi qu’il en soit et quoi qu’en pensent certains essayistes (Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc), le temps de la résipiscence semble venu pour l’Occident. Il a été précédé par une longue période d’oubli.
Les lois d’amnistie, initiées par les gouvernements successifs de la Vème République, dont la dernière a été voulue en 1981 par François Mitterrand pour remercier une partie des Pieds noirs d’avoir voté pour lui et qui rendent irrecevables devant les tribunaux français tout recours contre des crimes commis pendant la guerre d’Algérie, en restent le symbole. Il fallait tourner la page et réconcilier les Français.
Les archives, sur les périodes les plus récentes de la colonisation, sont longtemps restées difficiles d’accès et c’est encore le cas aujourd’hui pour une partie des archives militaires, concernant la guerre d’Algérie singulièrement. Ce qui n’a pas facilité le travail des historiens. Et les manuels scolaires, après avoir été partie intégrante du récit national pour vanter les bienfaits de la colonisation, sont restés longtemps muets sur la réévaluation de la colonisation après les indépendances acquises. Ce qui laissaient les enseignants démunis pour rendre compte, devant un public scolaire métissé, de cette “période douloureuse”, comme d’aucuns la qualifient pudiquement.
L’actualité politique est dominée par le froid diplomatique entre la France et l’Algérie dont le conflit mémoriel autour de la période coloniale a concerné, de part et d’autre de la Méditerranée, six générations au moins, alors que la solidité de France Afrique est stigmatisée comme une manifestation du néocolonialisme.
La question du passé colonial de la France, comme d’ailleurs celui des autres grands ex-empires européens (Grande Bretagne, Espagne, Portugal, Belgique), est d’une actualité brûlante, sauf à privilégier le déni et s’opposer au mouvement permanent de reconfigurations des mémoires nationales. Sauf à accepter d’être la victime consentante d’un retour du refoulé, avec son cortège d’anathèmes, d’incompréhensions mutuelles et de violences multiples entre les différentes catégories de la population.
Seule la Hollande a présenté ses excuses aux descendants de ses anciennes colonies. La France, quant à elle, semble avoir mieux traité la question de l’esclavage, aspect incontournable de la colonisation, que le fait colonial dans son ensemble.
Il ne faut pas s’attendre à trouver la réponse à la question qui sert de titre accrocheur à ce livre : Doit-on s’excuser de la colonisation ? Comme le souligne à raison Benjamin Stora, auteur d’un rapport récent sur Les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie, c’est au politique qu’il appartient de se saisir des propositions pour tenter de faire évoluer, s’il l’estime utile, le rapport complexe que notre pays entretient avec son propre passé colonial.
Plus qu’un jugement à la fois politique, moral et philosophique, comme celui de Karl Jaspers dans son maître livre sur un tout autre sujet De la culpabilité allemande, crimes contre l’humanité versus crimes de guerre, qui ne relève pas de la compétence de l’historien, le lecteur trouvera dans cet ouvrage un inventaire des enjeux de la question, un bilan à jour des recherches en pleine expansion sur le sujet et des recommandations pour l’avenir.
Points forts
C’est Maurice Halbwachs qui forgea le premier le concept de mémoire collective, jusqu’à affirmer sa prééminence par rapport à la mémoire individuelle. La mémoire, à la fois sujet et objet de l’histoire, source testimoniale et élément d’archive, est partie intégrante du travail de l’historien. Les acteurs historiques, ceux qui font l’histoire, sont détenteurs d’une certaine mémoire en fonction du camp auquel ils appartenaient et à laquelle ils demeurent fidèles. Alors que ce qui intéresse l’historien, c’est la vérité. Et d’abord le rétablissement de la vérité des faits.
Nos deux historiens, face à une histoire parfois récente, se placent au cœur de cette problématique différentielle et montrent comment l’histoire peut participer à la réconciliation du point de vue des acteurs dans un souci d’apaisement, de synthèse et d’échange, tout en ayant à l’esprit le souci constant de la vérité. En quoi l’ange de l’histoire de Walter Benjamin ne fait rien d’autre que de tenter de démêler les enjeux apparemment confus du passé, dans cette tempête de l’histoire dans laquelle ses ailes sont prises, pour éclairer le présent.
William Faulkner, qui s’y connaissait en matière de conflits de mémoire dans son grand Sud esclavagiste, avait raison de pointer « ce passé qui ne passe pas ». Les conflits de la mémoire sont en rapport avec une partie des enjeux qui animent des débats au sein de la société française actuelle. Quel regard porter sur la guerre d’Algérie, avec ses descendants de Pieds Noirs ou de Harkis, cette population immigrée venue du Maghreb, et les jeunes qui n'ont pas connu cette période ?
Ce livre a également le mérite d’effectuer un tour d’horizon de la recherche historique actuelle sur cette période. Malgré les réticences de certains grands Anciens, les études sur l’imaginaire colonial montrent à quel point les représentations ont pu forger la mémoire collective.
Il appartient à l’Honnête Homme du XXIème siècle de faire son miel de toutes ses pistes exploratoires.
Quelques réserves
Un jeune géographe, Yves Lacoste, qui créa ensuite la revue Hérodote, avait mis naguère le feu aux poudres dans le milieu universitaire en écrivant un pamphlet : La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre. Outre qu’on lui reprochait de vouloir politiser sa discipline, ce qui n’était sans doute pas faux, ses collègues critiquaient son manque de nuances. C’est la principale vertu, mise en avant par nos deux débatteurs, dont doit se réclamer tout historien dans son travail. Entre nous, Lacoste n’avait pas tout à fait tort dans son brûlot et on pourrait dire la même chose de l’histoire. En même temps on ne peut qu’être d’accord avec les auteurs, sauf à verser dans l’historicisme, que l’établissement de la vérité est le premier devoir de l’historien. Or cette vérité est forcément faite d’ombres et de lumière. A propos des crimes de guerre, pour revenir à cet exemple topique, cette qualification juridique est applicable, selon Stora, à certains faits de guerre, mais ne saurait résumer à elle seule la colonisation de l’Algérie.
Encore un mot...
Mon maître, Paul Ricoeur qui écrivit naguère La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli et dont le relecteur et assistant fut un certain président de la République toujours en exercice, concluait son livre, sur toutes ces questions tellement complexes et ambivalentes de temps, de mémoire, d’oubli, de récit et d’histoire et qui résument la problématique de ce livre, lui qui avait tout lu et en tant que Protestant avait fait serment de dire toujours la vérité.
Ces mots sont les suivants : « Sous l’histoire, la mémoire et l’oubli
Sous la mémoire et l’oubli, la vie
Mais écrire la vie est une autre histoire »
Une phrase
« Images fascinantes ou repoussantes, cocardières ou exotiques, racialistes ou économiques, patriotiques ou impériales, l’imaginaire colonial français va générer un flot iconographique massif. » Page 100
L'auteur
Pascal Blanchard est historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations. Il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages, films documentaires et expositions mais aussi de recueil Portraits de France pour la présidence de la République.
Benjamin Stora est historien, spécialiste de l’histoire de l’Algérie et des immigrations. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, mais aussi du rapport sur Les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie.
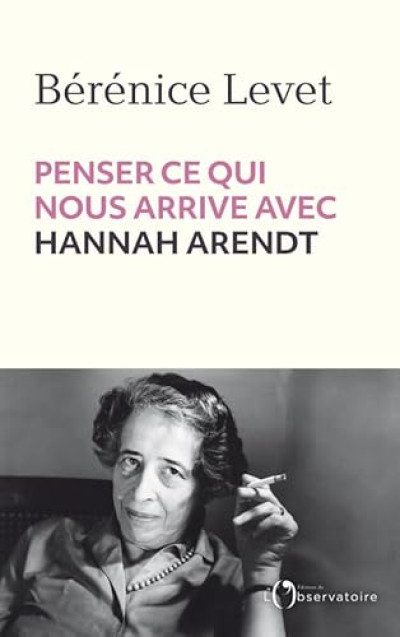
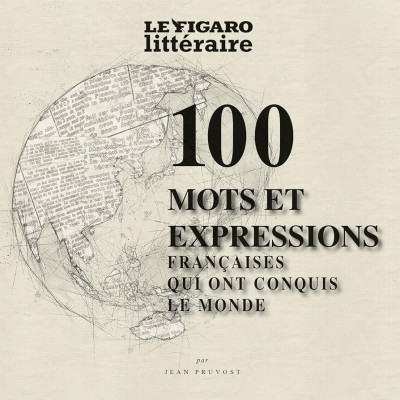
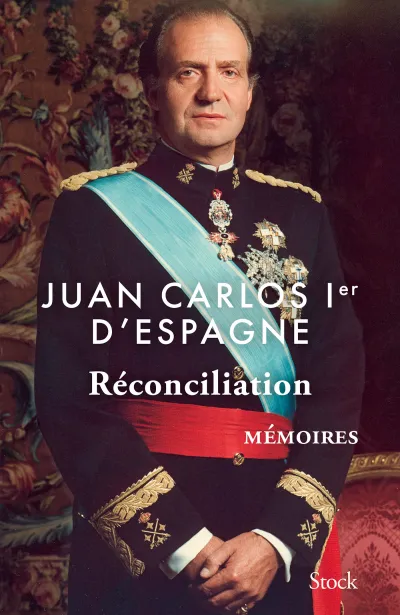

Ajouter un commentaire