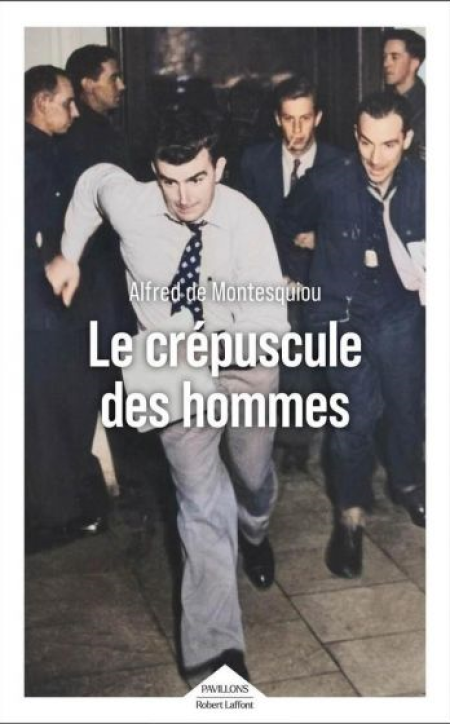
Le Crépuscule des hommes
Parution le 28 août 2025
383 pages
22 €
Infos & réservation
Thème
A l’automne 1945, juges, procureurs, avocats, journalistes et interprètes, témoins et victimes, la plupart du temps les deux à la fois, affluent vers la ville de Nuremberg dévastée par une guerre impitoyable qui, l’armistice à peine signé, menace déjà de renaître de ses cendres. Pour quoi faire ? Pour instruire ou commenter, selon son rang et son statut, le plus grand procès de l’histoire, celui de vingt-et-un criminels nazis et à travers eux, celui de l’Allemagne toute entière qui vient de basculer dans la ruine, l’effroi et la honte. Mais ce n’est pas tant le face-à-face de ces übermensch pitoyables que l’auteur propose, à coup de comptes-rendus d’audience plus ou moins exhaustifs, qu’un regard en creux sur un drame qui se joue dans le miroir.
Ainsi passée l’évocation du Palais de Justice néo-médiéval de la Franconie devant servir de théâtre à la reconstitution du crime, encore l’installation de tout cet aréopage cosmopolite dans le Grand-Hotel et dans le château de Faber-Castell, temple de l’opulence industrielle construit par un magnat du crayon et reconverti en auberge de jeunesse pour la circonstance, sera-t-il en substance question des conversations échangées entre les photographes et correspondants de presse américains, anglais, français ou russes, des intrigues politiques entre les juges, partagés entre les intérêts de leurs États, leurs ambitions personnelles et le peu de convictions qui leur reste, des rivalités entre journalistes à l'affût du scoop, et encore, comme dans toute société bien vivante, des intrigues amoureuses nouées par opportunisme ou par séduction ; les scrupules sont sans doute restés à la maison avec les épouses légitimes mais le réconfort dans les bras d’une autre est salutaire, presque vital devant cette humanité inhumaine.
Il sera bien sûr aussi question des « accusés », Goering en tête, le matamore abject, Keitel, Jodl et Ribbentrop, les dignitaires très indignes, Hans Frank, le boucher de la Pologne, Wilhelm Frick, le théoricien des lois raciales, Alfred Rosenberg, le héraut de la « race aryenne », et bien sûr tous les autres ; il sera question de leurs postures piteuses devant les témoignages et les réquisitoires, pendant tout le cours du procès et jusqu’au pied de la potence, de leur attitude bravache ou servile, de leur défense improbable oscillant entre inconscience et irresponsabilité, tous incarnant l’horreur et l’abjection, toutes les deux insondables.
Points forts
Un bon rythme, oscillant entre le théâtre et la pièce qui s’y joue, les premiers et les deuxièmes rôles, sans jamais lasser le lecteur, même s’il se perd un peu dans la foule de tous ces gens qui font la trame de l’histoire.
Une documentation inouïe, à la base d’un essai qui pourrait passer pour un roman - noir, très noir - une richesse de détails qui fourmillent sur la vie des uns et les motivations des autres, au service d’une description exhaustive du procès et de tous ses protagonistes, une documentation dans laquelle tout compte, l’abjection des prévenus, le regard perdu des témoins, la souffrance inextinguible des victimes qui n’ont survécu que pour ce moment, pour raconter au monde ce dont l’homme a été capable, et aussi, en contrepoint de cette horreur évoquée avec parcimonie pour dire l’essentiel sans lasser, la bonhomie d’un barman qui prépare des cocktails, l’astuce d’un photographe qui traque l’image la plus probante, le sentiment amoureux et son inépuisable message d’espoir.
La restitution éblouissante du témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier (page 177) qui rend coite l’interprète, incapable de trouver des mots dans sa langue pour en restituer la pertinence.
Quelques réserves
Aucune, sinon celles que les points forts commandent, cette abondance de noms, de fonctions, d’affectations ou de rôles simplement vécus, subis ou assignés, voulus ou ambitionnés.
Encore un mot...
On savait tout ou presque de ce procès, du moins le pensait-on, sans doute naïvement ! On connaissait les Juges et les Procureurs, les prévenus surtout et leurs rôles dans cette inimaginable organisation du crime. Pour donner toujours de ce procès l’aspect qu’il devait avoir, celui d’un monde crépusculaire qui ne doit jamais revenir, la fermeture d’une parenthèse épouvantable, une espèce d’exorcisation.
Le génie de ce livre est sans doute de n’en rien négliger d’essentiel mais d’aller au-delà, de définir les contours du « huis-presque-clos » à travers le regard de ceux qui étaient là précisément pour ça, ainsi le procureur général Jackson, Ray D’Addario, le photographe intrépide dont l’idylle sincère avec Margarete, une interprète sudète, illumine le récit par l’espoir qu’il fait naître, celui de la vie qui triomphe de la mort. Car c’est bien là la vertu du livre, le triomphe de la vie. Sans doute faut-il lire, avant plutôt qu’après, la vision alternative de ce procès unique proposée par Jean-Marc Varaut, l’illustre pénaliste français (Le procès de Nuremberg, Perrin, 2002), qui l’analyse jusque dans ses tréfonds et rend compte de ses enseignements décisifs sur le « génocide » et le « crime contre l’humanité », deux visions en somme pour tenter de comprendre l’incompréhensible.
Une phrase
« Vous auriez dû la voir, il y a quelques instants, lorsqu’elle a quitté la salle », lui lance l’Américain. Un silence d’effroi s’est installé, raconte-t-il, presque fébrile. Au lieu de sortir par la porte des témoins, au fond à gauche de la salle d’audience, derrière les box des traducteurs, Marie-Claude Vaillant-Couturier a choisi de traverser tout le prétoire. Elle a marché juste devant les accusés, en ralentissant le pas pour planter ses yeux dans les leurs. Pas un n’a osé soutenir son regard, je vous jure, Margarete, j’en tremblais ! poursuit Ray. Sauf peut-être Göring, mais il était blême quand elle est passée juste devant lui. J’ai cru que la Française allait le gifler ou hurler une insulte. » Page 183
L'auteur
Sans attendre l’issue de brillantes études qui lui vaudront une maîtrise de philosophie à la Sorbonne, le diplôme de Sciences-Po (IEP) et un master de journalisme de la prestigieuse université américaine de Columbia, Alfred de Montesquiou - né en 1978 - se lance très jeune dans une impressionnante série de voyages dans le désert du Sahara, sur les traces de Théodore Monod. Correspondant de presse, il couvre la chute du président Aristide à Haïti, vit entre le Soudan et l’Egypte un temps, avant de devenir reporter de guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye et à Gaza pour Associated Press, l’agence américaine. Il s’intéresse au génocide du Darfour, enquête sur les crimes contre l’humanité et la Cour pénale internationale. Grand reporter pour Paris-Match, il couvrira encore « le Printemps arabe », la guerre en Iran, la guerre en Ukraine…
Ses voyages et ses reportages clandestins nourrissent sa plume, ainsi Oumma, un grand reporter au Moyen-Orient (Prix Nouveau Cercle Interallié. Seuil, 2014) et L’Etoile des frontières (Stock, 2021) et beaucoup d’autres qui le mettront souvent en danger. Auteur-réalisateur d’une bonne dizaine de documentaires, il s’est encore illustré par la réception du prix Albert Londres en 2012.
Sur notre site, Moi, Jules César, une BD historique scénarisée par Alfred de Montesquiou
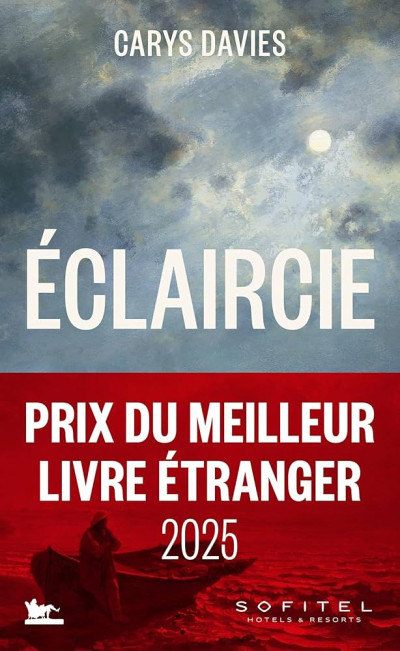
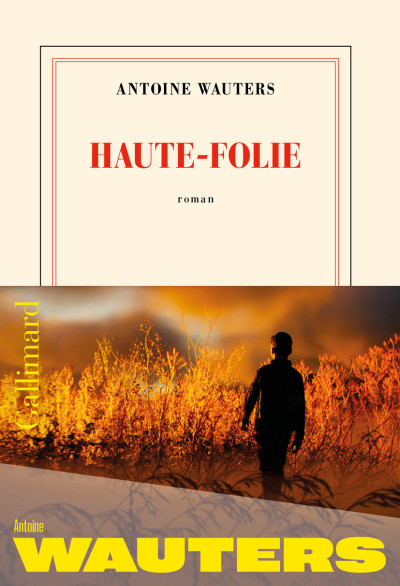
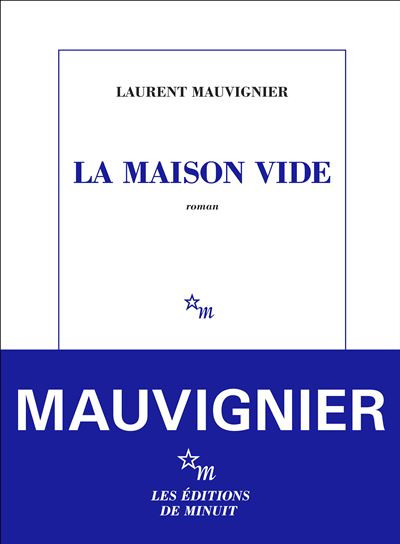
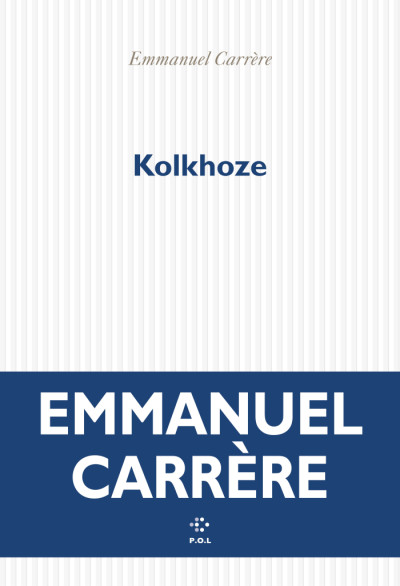
Ajouter un commentaire