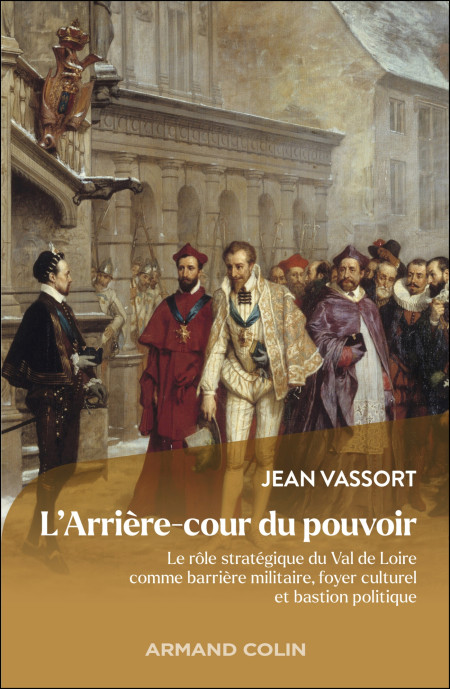
L’Arrière-cour du pouvoir. Le rôle stratégique du Val de Loire comme barrière militaire, foyer culturel et bastion politique
Publication le 12 février 2025
293 pages
23 euros 90
Infos & réservation
Thème
Un long prologue introduit cet essai remarquable. De la Gaule romaine à la fin du Moyen- Âge, des invasions à la Renaissance, l’auteur situe très précisément l’Histoire en Val de Loire : refuge, barrière, axe de communication, villégiature, vitrine.
Nous parcourrons ensuite plusieurs chapitres bien définis, chacun détaillé en nombreux thèmes.
La chronologie que nous propose l’auteur, du repli de Charles VII à Bourges jusqu’à l’époque de l’Après- guerre, n’empêche pas quelques retours en arrière et répétitions permettant de suivre facilement la complexité de cette arrière-cour du pouvoir.
Le lecteur suit toutes les décennies qui ont vu naître les châteaux royaux d’une cour nomade en province ligérienne. La politique qui y a été menée, la renommée qui en a découlé, ont marqué de leur empreinte cette terre de villégiature et de pouvoir, de refuge et de disgrâce .
Nous accompagnons les rois et les Grands, les ministres royaux, les grandes figures de l’Eglise, des arts et de la littérature, les marchands, artisans, ouvriers, bateliers, vendangeurs, soldats, le tout dans le bruissement des réjouissances ou le vacarme des combats, ou encore le silence des échecs et bannissements. Moult dates et noms s’inscrivent dans le paysage historique d’une province privilégiée, évoquant ainsi le fonctionnement des arcanes du pouvoir : Bourges, Orléans , Tours, Amboise, Blois …. , sont la destination d’une cour nomade éloignée de la capitale, Paris. Aux côtés des rois de France, au rythme des alliances, mariages, deuils, fêtes, complots, nous avançons jusqu’à la période de la Révolution puis de l’Après -guerre.
Points forts
C’est un plaisir de lire un essai au style alerte et soutenu et au vocabulaire châtié.
L’écriture est simple, riche et légère.
Les notes renvoient à une bibliographie abondante.
Le récit est nourri de réflexions qui expriment l’analyse de l’état du pouvoir en province ligérienne.
Les plus érudits trouveront de nombreux détails pertinents sur cette histoire en Val de Loire. Les autres pourront apprécier des pages imagées, plaisantes, intrigantes.
Quelques réserves
Vraiment très peu. Le lecteur attentif peut remarquer quelques très rares anachronismes de vocabulaire.
Mieux valait-il, peut- être, ne pas évoquer les combats au Mans pendant la Guerre de Vendée plutôt que de les effleurer ?
Encore un mot...
Cet ouvrage de niveau universitaire est dépourvu de toute aridité, et se lit comme une belle leçon d’Histoire. Le lecteur devient avide et curieux, et clôt à regret cette promenade avec les hommes du Val de Loire dans leur diversité et la saveur de leur vécu.
Une phrase
« En octobre 1428 , Salisbury vient mettre le siège devant Orléans, verrou qui commande le franchissement de la Loire. Et durant l’hiver, les Orléanais apparaissent incapables de desserrer l’étau : le 12 février, leur coup de main contre un convoi anglais de poisson séché échoue. L’échec de cette « journée des Harengs » conduit Charles VII à envisager un instant d’abandonner l’Orléanais, le Berry et la Touraine pour se replier dans le Midi. » page 67
« Autre château en vue de l’époque, celui de Blois, où prennent place les initiatives de Gaston d’Orléans, le frère de Louis XIII. Résidant dans la ville, qui dépend de son apanage orléanais durant les années 1630, depuis qu’il y a été exilé en 1634, puis à nouveau après la Fronde jusqu’à sa mort en 1660, il y entretient à chaque fois une importante cour dont le visage évolue d’un séjour à l’autre. Durant le premier, c’est une cour animée et joyeuse qui entoure le prince, dans un esprit curieusement à la fois dévot et libertin, à l’image de ce dernier. Pour la ville, sa présence entraîne une reprise des activités de luxe, orfèvrerie et horlogerie. Mais elle entraîne surtout un projet de remodelage du château. A la demande de Gaston, l’architecte Mansart prévoit de démolir entièrement le château existant pour lui substituer un nouvel édifice organisé autour d’une cour rectangulaire et précédé d’une avant-cour entourée d’un portique continu, relié à la ville vers l’est par une allée percée dans l’axe du château, ce dernier étant flanqué à l’ouest d’une terrasse enjambant les fossés et s’ouvrant sur un vaste jardin à la française. Mais ces travaux, qui démarrent en 1635 et semblent alors constituer la réponse du turbulent frère du roi au château du cardinal Richelieu, ralentissent nettement en 1638, quand le roi, ayant enfin un fils, réduit les moyens financiers du duc, qui a cessé d’être un héritier présomptif de la Couronne. » page 182
L'auteur
Jean Vassort, né en 1947, est agrégé d’histoire et docteur d’Etat de l’université Paris-Panthéon-Sorbonne, et professeur honoraire de khâgne au lycée Descartes à Tours.
Il collabore à de nombreux ouvrages universitaires : Une société provinciale face à son devenir (1995); Les papiers d’un laboureur au siècle des Lumières (1999); Les châteaux de la Loire au fil des siècles art, politique, société ( 2012); Histoire de la Renaissance (2018); L’art des jardins en France du Moyen Age à nos jours ( 2020); Le siècle des Lumières (2022).

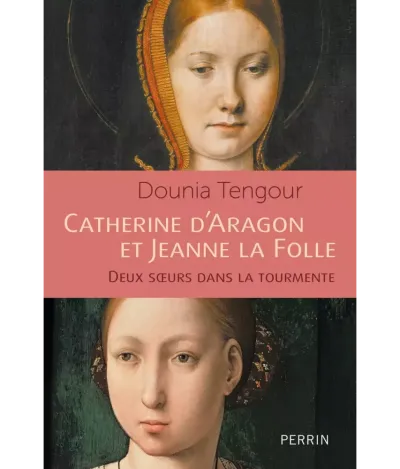
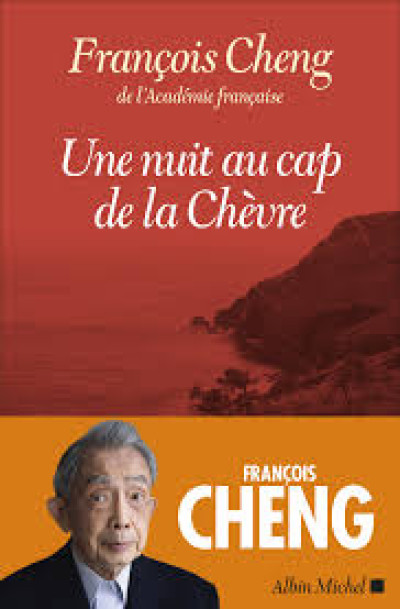
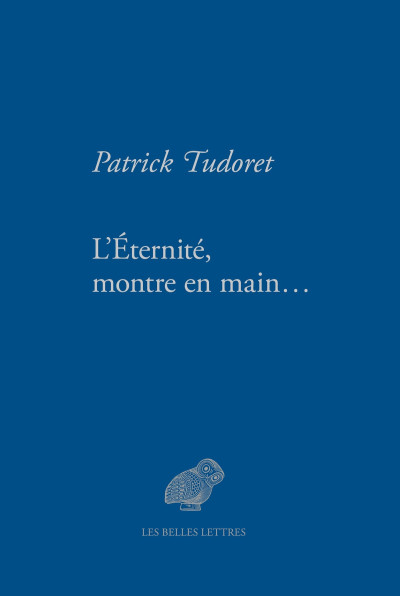
Ajouter un commentaire