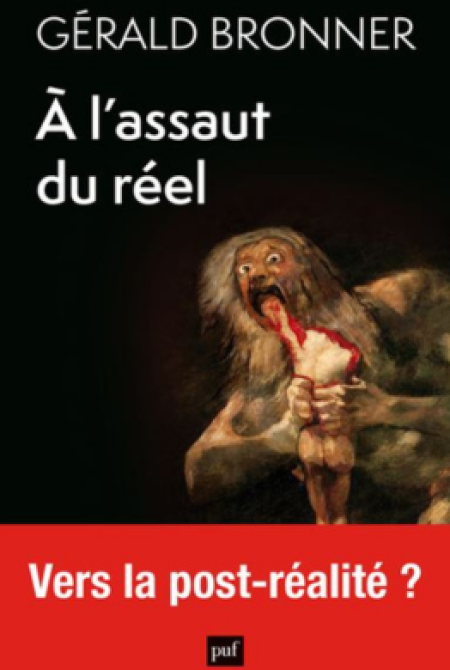
A l'assaut du réel
Publication le 27 août 2025
430 pages
22 €
Infos & réservation
Thème
A l'aube des récits fondateurs était l'Epopée de Gilgamesh, ce roi mésopotamien qui refusait l'idée de la mort. De ce récit sont peut-être nées les grandes religions monothéistes, et sans provocation excessive de l'auteur de cet essai, la première manifestation de la "post-réalité". Derrière ce terme se cachent toutes les stratégies qui depuis des siècles, mais plus encore des décennies, invitent les humains à penser le monde selon leur désir ou leur croyance, et non selon les critères de la pensée scientifique.
Si cette entrée en matière paraît provocante, elle synthétise ce que Gérald Bronner propose d'illustrer : avec l'ère numérique, la vérité devient source de controverse, le réel source de souffrance. Il ne s'agit pas ici de l'affirmer mais de le démontrer. De l'enfant qui transforme le réel selon sa volonté à la pensée magique qui affleure souvent en chacun de nous, de l'affirmation qu'il faut être réaliste "et demander l'impossible", aux innombrables communautés qui affirment identités, différences et vérités alternatives sur le net - le réel, c'est-à-dire "ce qui continue d'exister lorsque l’on cesse d'y croire", a quelques soucis à se faire.
Dans cet essai extrêmement documenté, nourri de très nombreux exemples précis et concrets, le sociologue analyse les causes de ce mouvement profond et polymorphe. Il serait un symptôme de la peur de déclassement et de la perte de repères qu'ouvrent le foisonnement des sources d'informations et la "décadence de l'idée de progrès" dans nos démocraties. Bronner interroge : pourrons-nous vivre dans un monde qui, de Hong Kong au Canada et de la Nouvelle Zélande au Groenland, s'accommoderait du fait que toute vérité est relative ? A l'assaut du réel alerte sur la nature et les conséquences de l'effacement des frontières entre un "réel" fondé sur les connaissances issues de la démarche scientifique et toutes les formes de fictions auxquelles les mondes numériques offrent une audience historiquement inédite.
Points forts
Tout est fort dans cet essai.
Le cheminement suivi par Gérald Bronner est d'abord très analytique. Il s'attache à montrer que de tous temps, l'homme a cherché à s'affranchir du réel, que cette attitude soit propre à l'enfance, propre à toutes les civilisations dites "modernes" autant qu'aux peuples premiers. Anthropologie, mythologie, psychiatrie, sociologie apportent leurs éclairages précis et documentés.
Ensuite, son analyse n'affirme pas sans exemples. Et sur ce terrain le livre est absolument foisonnant, en particulier quand il va chercher dans nos sociétés contemporaines, les stratégies individuelles ou collectives d'évitement, de transformation, de refus du réel. On découvre à ce titre d'étonnants comportements, comme les nikimori qui se retranchent des années dans leurs chambres, les shiffers, explorateurs de mondes parallèles, adeptes des Métavers, les thérians, qui se sentent animaux, les fury qui s'identifient et se déguisent en animaux de dessins animés, sans oublier les innombrables revendications d'unions avec des objets, des arbres ou encore des animaux. Cela pourrait paraître anecdotique devant (parfois) la faiblesse du nombre d'adeptes de ces pratiques, cela l'est moins quand ces théories imposent dans les enseignements que la terre est plate, ou qu'il est urgent d'investir des milliards de dollars pour composer une humanité "2.0" détachée du temps de la biologie et programmée immortelle par la force du codage numérique.
Une des qualités de l'essai est la mise en lumière de l'influence de ces "dérives" sur la perception de l'avenir et plus largement, la cohésion sociale. Dans cet inventaire qui peut étonner par sa diversité et consterner par la bienveillance souvent exprimée devant les déformations du réel, Gérald Bronner ne porte pas de jugement, mais témoigne. Il est intéressant de noter qu'il conclut avec cet essai un cycle de recherches et de publications, ouvert par La démocratie des crédules (Puf 2013), et Apocalypse cognitive (Puf 2021).
Enfin, outre le fait que son analyse est très riche de connaissances et de découvertes pour les non spécialistes, l'auteur s'exprime à la première personne, ce qui rend son propos très accessible, parfois drôle et très stimulant.
Quelques réserves
Peut-on reprocher à un expert la multiplication de la citation de ses sources ? Des grands noms de la science, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de la psychanalyse, de l'économie 2.0 ou encore des "vérités" alternatives, parsèment les pages. Il faut être expert pour les connaître tous ; il faut l'être aussi pour maîtriser certains mots de vocabulaire. Mais leur insertion dans le texte mérite, si on ne les comprend que vaguement, le détour par un dictionnaire (un vrai) !
Encore un mot...
Ce livre invite à découvrir toutes les stratégies d'évitement du réel que l'homme s'est forgées et que nos sociétés technologiques rendent possibles et "recevables" - car expression de "vérités intimes". A l'assaut du réel est un essai à la foi passionnant et consternant. Passionnant car il analyse des phénomènes qui sont à la surface ou au cœur de nos vies : les algorithmes des réseaux sociaux, les théories platiste, créationniste, antispéciste, les fake news, le transhumanisme et l'aspiration à l'humanité 2.0… La liste pourrait être longue, si ne sont cités ici que les plus connus et débattus. Consternant, car quelle serait une société sans consensus sur une vision du passé, du présent et de l'avenir ?
Consternant devant les formes que prennent les droits revendiqués à la différence, comme de se marier avec un mur ou la Tour Eiffel, être amoureux d'un avatar numérique, se déclarer chien ou loup quand ce n'est de s'attribuer, au gré de ses humeurs, l'identité que l'on veut. Se présenter au monde selon ses désirs et non selon la réalité du monde pose des questions éthiques et philosophiques qu'il ne faudra pas éluder. Les deux extrêmes du voyage mouvementé que nous offre ce livre sont le rejet de plus en plus marqué des contraintes biologiques et sociales, et l'aspiration transhumaniste qui rêve d'un âge d'or où le temps serait arrêté. Un voyage aux confins de l'imaginable, selon l'auteur, dans lequel "le réel n'existe pas et le possible, immense, au-delà de toute limite". Parce que la dystopie de 1984 décrite par Georges Orwell n'est vraiment pas loin, ce livre est à lire absolument !
Une phrase
"Si la corruption du réel bénéficie de la dérégulation du marché cognitif, ce n'est pas seulement en raison de l'activité de crédules motivés et de l'action néfaste des algorithmes : nos cerveaux ne sont pas irresponsables de la situation.
En effet, ce qui se produit depuis quelques années, c'est une fluidification entre l'offre et la demande d'information. Dans ce contexte hautement concurrentiel d'économie de l'attention, les propositions intellectuelles les plus intuitives - celles qui vont dans le sens de nos attentes cognitives spontanées - partent avec un avantage." P 277"Le corps, qui est notre interface pour accéder au réel, est l'obstacle principal à l'impérialisme de la pensée désirante.
Ce corps visqueux, qui n'accepte de n'être rien d'autre que ce qu'il est, devient le symptôme le plus patent de l'imperfection du monde. Les uns imaginent un être originel dévoyé par le contexte pervers dans lequel ils sont obligés de vivre (qui créerait des particularismes de sexe et de préférences sexuelles, des séparations ontologiques entre les espèces ou même avec le non-vivant), les autres subodorent qu'un tel être parfait adviendra au terme de l'histoire du monde.
Origine et fin s'arcboutent pour former le cercle d'un imaginaire qui rejoint étrangement les récits mythologiques auxquels nombre de cultures humaines ont contribué." P 381
L'auteur
Gérald Bronner est un sociologue français. Il enseigne notamment à la Sorbonne et son expertise sur les représentations et croyances sociales le conduisent à être membre de l'Académie de médecine, de l'Académie des technologies et de l'Institut Universitaire de France. Pour L'empire des croyances, publié en 2003, il reçoit le prix de l'Académie des sciences sociales et politiques. Passionné des questions énergétiques, des mondes numériques, du complotisme, il publie régulièrement dans de nombreuses revues spécialisées et magazines.
Il a publié une vingtaine d'essais, dont Apocalypse cognitive, qui a reçu le Prix Elina et Louis Pauwels de la Société des gens de lettre et le prix Aujourd'hui (décerné par des journalistes) en 2021, prix qui récompensent un auteur d'essai éclairant un débat actuel de notre société.
Sur Culture-Tops, vous pourrez lire également la chronique de son essai Exorcisme.
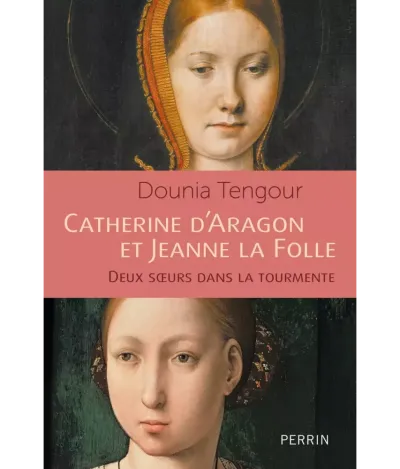
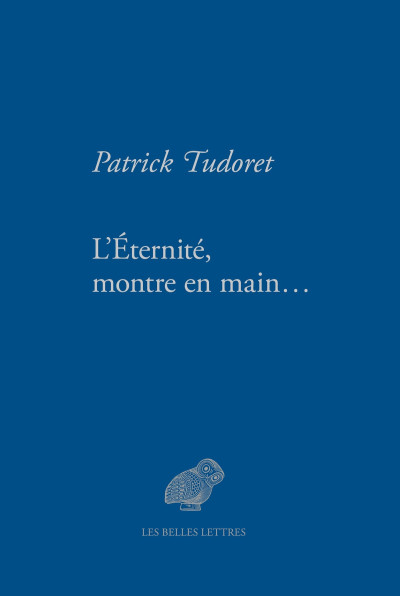
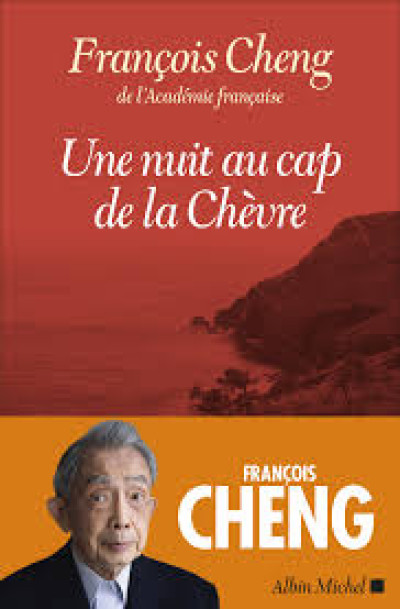

Ajouter un commentaire