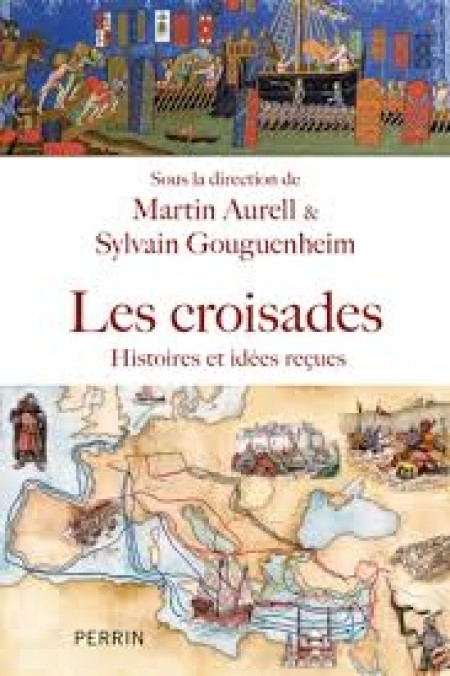
Les croisades. Histoires et idées reçues
Perrin
Publication le 15 mai 2025
400 pages
23,5 €
Infos & réservation
Thème
En 1095, le pape Urbain II lança, à Clermont Ferrand, la première croisade contre les “infidèles“, en l'occurrence les musulmans qui avaient occupé et pris le contrôle des Lieux Saints. Après de premiers succès initiaux, la prise et la fondation du royaume de Jérusalem qui devait durer près d’un siècle, les Latins ont progressivement perdu pied au Moyen-Orient. Sans succès, de nouvelles croisades ont été lancées pour récupérer les Lieux Saints, jusqu’en 1270, quand, lors de la septième et dernière tentative, Saint Louis périt à Tunis.
Par ailleurs les papes ont prêché d’autres guerres saintes contre des “païens“, essentiellement en Europe de l’Est (Prusse et pays baltes), et en Espagne, voire dans le Sud-Ouest de la France (Albigeois).
C’est cet ensemble de conflits, menés pour la plus grande gloire de Dieu, que retrace l’ouvrage collectif réalisé sous la direction de Martin Aurell et de Sylvain Gouguenheim, rassemblant 19 contributions qui éclairent d’un jour nouveau un sujet qui prête souvent à des analyses simplistes et manichéennes qui ont enraciné bien des idées reçues.
Points forts
La méthode retenue offre en effet une approche globale du phénomène, puisque les monographies s’articulent bien entre elles. Le lecteur peut ainsi comprendre la problématique des croisés eux-mêmes, des papes, des empereurs byzantins, des musulmans et des Turcs… Elles s’emboîtent comme dans un jeu de construction et offrent un tableau assez complet des croisades, tout en approfondissant des aspects souvent méconnus, comme la différence entre les notions de croisade, guerre sainte et le djihad musulman.
Les motivations tant religieuses que sociologiques qui ont poussé les Occidentaux à prendre la croix sont aussi analysées avec finesse.
Les auteurs expliquent les raisons de la lente érosion des possessions franques au Levant; le rôle et l’histoire des ordres militaires, comme les Templiers ou les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ancêtres de l’ordre de Malte, ou les Chevaliers Teutoniques actifs au Nord-Est de l’Europe.Ils mettent à mal quelques idées reçues, comme la conviction que Philippe le Bel a détruit les Templiers pour s’emparer de leurs richesses, alors qu’il s’inquiétait de l’emprise du pape sur son royaume.
On apprend aussi la vigueur des principautés franques en Grèce (Morée), les raisons du sac de Byzance par les croisés en 1204, ou la logique de la reconquête de la péninsule ibérique par les rois catholiques…
Quelques réserves
Cette approche kaléidoscopique des croisades a les défauts de ses qualités. Ces récits, parfois sans grand rapport avec ceux qui les ont précédés, présentent parfois des réalités complexes que le lecteur peine à assimiler dans un format aussi cursif; ainsi les guerres des Chevaliers Teutoniques, dans la Prusse orientale et la Livonie, mériteraient des développements plus nourris pour le lecteur profane.
Parfois aussi, la très grande érudition de ces universitaires les conduit à exposer un luxe de détails qui ne sont pas indispensables au tableau d’ensemble. Le plaisir de lire peut en être tempéré.
Encore un mot...
Une présentation impressionniste des croisades, prises lato sensu (au sens large), qui apporte une connaissance fine de cette période, révèle des épisodes peu connus et fourmille d’analyses fines et riches de détails. À une époque où la question de la cohabitation de l’Islam et de l’Occident est posée, il n’est pas inutile de comprendre comment la confrontation des croisés avec le monde musulman a pu modeler les mentalités collectives, jusqu’à aujourd’hui, et aussi offrir une grille de lecture subtile des rapports entre ces deux communautés.
Une phrase
« La volonté d’aller délivrer les Lieux Saints aux mains des infidèles est un autre élément d’interrogation pour les Byzantins, et ce pour plusieurs raisons. Depuis le VIIe siècle et les conquêtes arabes en Syrie, Palestine ou Égypte, chrétiens et juifs continuent d’y vivre sous l’administration des conquérants, qui s’avère durable. Ils obtiennent le statut de dhimmi, conservant liberté et lieux de culte en échange d’impôt supplémentaire, le jizya, que ne versent nullement les musulmans. En outre, pèlerins et visiteurs chrétiens peuvent se rendre assez aisément à Jérusalem et dans les lieux associés au berceau du christianisme. » Page 127
L'auteur
Les auteurs sont des universitaires spécialistes du Moyen Âge, sous la direction de Sylvain Gouguenheim, professeur d’histoire médiévale à l’École normale supérieure de Lyon, auteur entre autres d’une biographie de Frédéric II Hohenstaufen, et du professeur Martin Aurell, spécialiste des Plantagenêts et biographe d’Aliénor d’Aquitaine, malheureusement disparu en 2025.

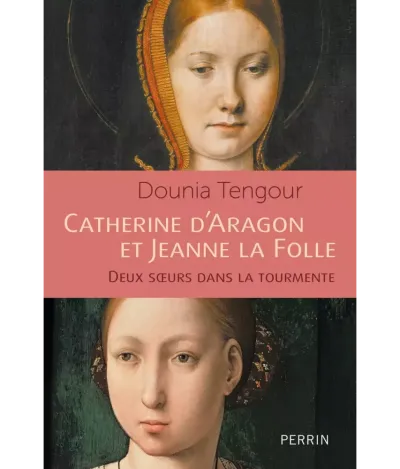
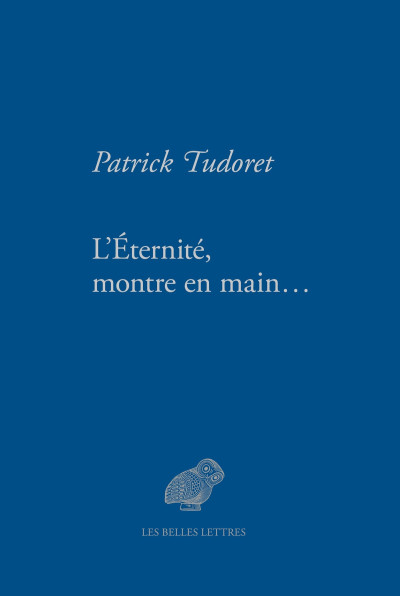
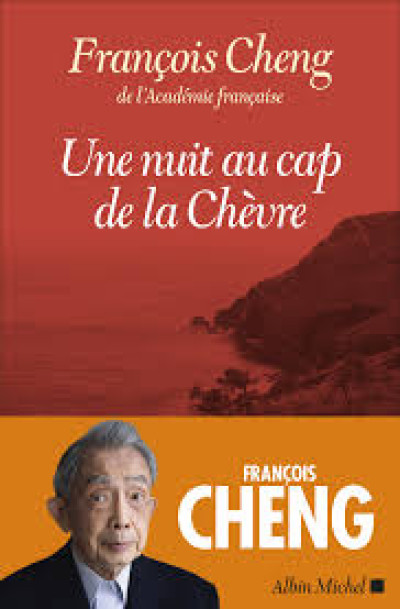
Ajouter un commentaire