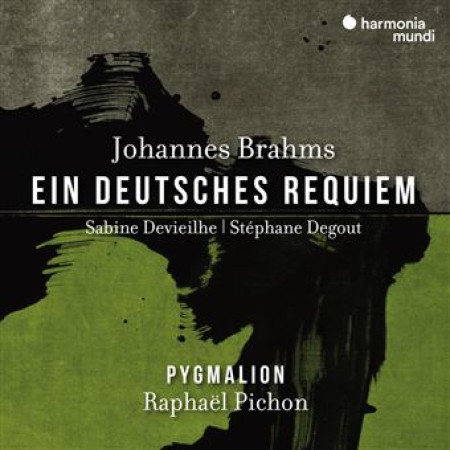
Ein Deutsches Requiem, pour soli, chœur et orchestre de Johannes Brahms
Sabine Devieilhe, soprano
Stéphane Degout, baryton
Harmonia Mundi
Publication le 10 octobre 2025
CD 17,99 €
Infos & réservation
Thème
« Aimez-vous Brahms ?” interrogea jadis le titre de l’un des nombreux romans de Françoise Sagan qui eut le succès que l’on sait dans les années 50. Question à vrai dire assez niaise, fleurant son pesant de frivolité salonarde propre à une bourgeoisie décadente, tant elle frappe par sa généralité peu inspirante. Mais, au moins, eut-elle le mérite en son temps de citer de l’un des plus grands compositeurs du romantisme finissant et plus précisément du romantisme d’Outre-Rhin. C’est ainsi que Brahms qualifia son Requiem d’allemand, encore qu’il ne faille pas interpréter Ein Deutsches Requiem dans un sens étroitement nationaliste : nulle prétention germanique dans son intitulé mais au contraire, une possibilité offerte parmi d’autres d’honorer la mémoire des disparus en une forme d’humilité universaliste, aux antipodes par conséquent de l’arrogance wagnérienne lancée à son époque dans une offensive esthético-politique de grande envergure.
Du reste, n'a-t-il pas déclaré plus tard qu'il aurait pu supprimer du titre le mot "allemand" pour le remplacer simplement par "humain" ? C’est en hommage à son maître Robert Schumann et à sa mère qu’il entreprit de composer cette œuvre aux vastes dimensions, d’inspiration en réalité plus spirituelle que religieuse comme en témoignent les textes insérés dans la partition qui évitent toute référence au corpus théologique habituellement mobilisé dans la liturgie catholique. Créée en 1868 à Brême, elle précéda d’à peine quelques années le Requiem de Verdi (1874). Conscient de vivre au soir d’une grande époque qui avait permis l’éclosion du classicisme viennois jusqu’en ses ultimes développements beethovéniens, ce fils de l’Allemagne du Nord cultiva une profonde et irrésistible mélancolie.
Points forts
C’est l’un des grands mérites de la version que nous propose l’ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon que de faire ressortir la dimension toute intérieure d’une œuvre requérant pourtant un dispositif orchestral et choral de grande ampleur. Au-delà de son apparence monumentale, ce Requiem n’a rien de colossal ni de péremptoire : il propose plus simplement un chemin aux consciences malheureuses d’avoir perdu un être cher, qui ne soit ni celui d’une vallée de larmes sans espoir ni celui d’un paradis déjà là offert à qui pourrait s’en saisir. Plus modestement, il fait retour sur la fragilité de la vie terrestre, ses difficultés, sa grandeur aussi et ses joies.
Nous sommes moins dans la prédication chrétienne avec son lot d’injonctions intimant de se soumettre au jugement d’un dieu surplombant que dans l’humble position du pèlerin cherchant à s’accommoder de la précarité de son parcours semé d'embûches : registre de la puissance réparatrice de la consolation, moments où la grandeur cède la place à la vulnérabilité de l’expérience humaine, et où le dépouillement atteint à l’essence du monde intérieur, espace d’émerveillement, de recueillement silencieux et d’humanité. L’orchestre ne se contente pas d’accompagner les solistes, soprano ou baryton, ils respirent ensemble, en une alternance qui nous fait passer de l’intimité la plus profonde aux célébrations chorales les plus exaltées. Ainsi de la tension entre la densité instrumentale et la pureté vocale qui se nourrissent l’une l’autre au service de l’ambition expressive d’une œuvre disant en un même mouvement l’affliction et la joie. On pourrait en ce sens parler d’une anthropologie brahmsienne qui, sur fond de mélancolie comme donnée immédiate de la conscience humaine, laisserait entrouvertes les possibilités de l’apaisement.
Dans ce Requiem à hauteur d’homme où pourrait s’entendre une forme d’autobiographie musicale exprimant les doutes, la douleur et la recherche du réconfort, Brahms n’aurait-il pas voulu nous dire, avant que Cesare Pavese, quelques années plus tard, n’écrive Le métier de vivre, son dur métier de vivre à lui, dont l’amour inassouvi pour Clara Schumann lui laissa un goût de frustration et d’infinie tristesse.
Quelques réserves
Aucune réserve pour cette extraordinaire et récente version du Requiem allemand de Brahms.
Encore un mot...
Faut-il souligner la pureté et l’expressivité rares des voix de Sabine Devieilhe (soprano) et de Stéphane Degout (baryton) comme indispensables parties prenantes d’un discours musical exprimant une profonde adhésion à la vie ? Dans un climat de tendresse et de douceur où l’expression du sentimentalisme foncier du compositeur, d’une extrême délicatesse, est exempte de toute sensiblerie, nous voilà parvenus dans un monde où bonheur extatique et gravité sereine se répondent en un incomparable jeu d’échos.
L'auteur
Le chef d'orchestre Raphaël Pichon, né en 1984, commence son apprentissage musical à travers le violon, le piano et le chant en se formant dans les différents conservatoires de Paris (CNSMDP & CRR). Jeune chanteur professionnel, il est amené à se produire sous la direction de personnalités telles que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, ou encore au sein des Cris de Paris de Geoffroy Jourdain, avec lequel il aborde la création contemporaine.
Il fonde en 2006 Pygmalion, chœur & orchestre sur instruments d’époque, qui se distingue rapidement par la singularité de ses projets. Tout l’œuvre de Johann Sebastian Bach, les versions tardives des grandes tragédies lyriques de Rameau, la mise en perspective de raretés mozartiennes et l’exploration du répertoire romantique sont autant de projets qui fondent l’identité de Pygmalion. Par un travail centré sur la fusion entre chœur et orchestre, les différentes réalisations de Pygmalion sont rapidement saluées unanimement en France et à l’étranger. Aux côtés de son ensemble, Raphaël Pichon se produit notamment à la Philharmonie de Paris, au Château de Versailles, aux BBC Proms, au Bozar Bruxelles, au Konzerthaus de Vienne, à la Philharmonie de Cologne, au Palau de la Música Catalana de Barcelone, au French May de Hong-Kong ou encore au Beijing Music Festival.
Sur la scène lyrique, Raphaël Pichon dirige différentes productions à l’Opéra Comique, au Festival lyrique d’Aix-en-Provence, au Théâtre du Bolchoï à Moscou, à l’Opéra d’Amsterdam, à l’Opéra National de Bordeaux. Il collabore ainsi avec des metteurs en scène tels que Katie Mitchell, Romeo Castellucci, Simon McBurney, Michel Fau, Pierre Audi, Jeanne Candel, Jochen Sandig, Cyril Teste, Aurélien Bory, Satoshi Miyagi, Laurent Pelly ou encore Jetske Mijnssen.
Ses nombreux enregistrements paraissent chez Harmonia Mundi. Les dernières parutions sont l’opéra imaginaire Enfers avec le baryton Stéphane Degout (2018), Libertà ! autour des chefs-d’œuvre méconnus de Mozart, les Motets (2020) et la Matthäus-Passion (2022) de J-S. Bach, Mein Traum (Schubert, Schumann, Weber), nouvelle collaboration avec Stéphane Degout (2022), Vespro della Beata Vergine de Monteverdi (2023). Chez Erato, paraît en 2021 le disque Bach-Handel avec Sabine Devieilhe. L’intégralité de sa discographie a été acclamée unanimement en France et à l’étranger.
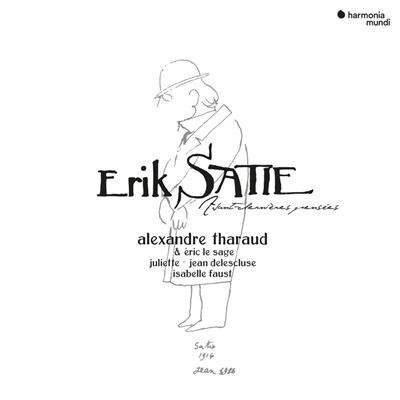
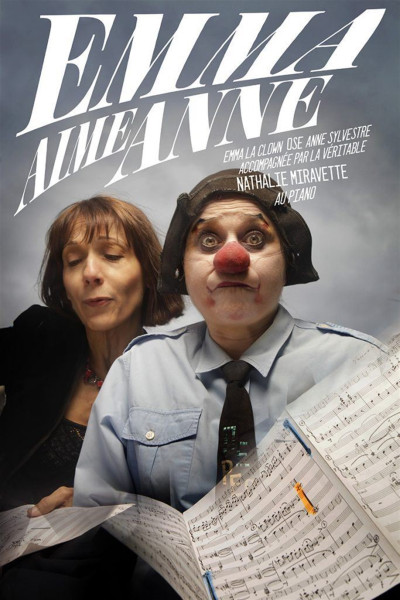
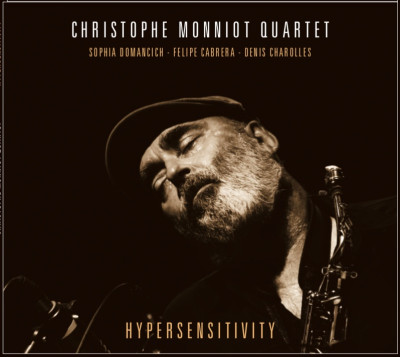
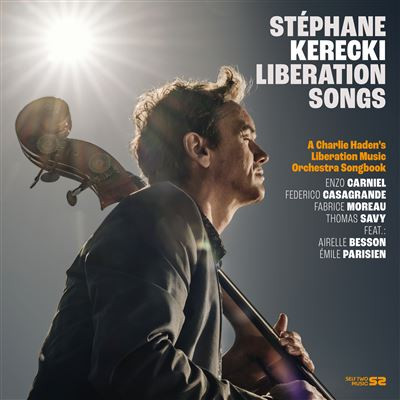
Ajouter un commentaire