
Straight Horn
Parution le 10 octobre 2025
15 Euros
Infos & réservation
Thème
Ce titre, Straight Horn, qui désigne en fait l’autre manière d’appeler le saxophone soprano, le seul de la famille inventée par le Belge Adolph Saxe avec le sopranino, qui soit droit et non pas alambiqué, c’est aussi un jeu de mot sur le patronyme de l’arrangeur Billy Strayhorn, l’âme damnée, l’ombre de l’ombre de Duke Ellington, son double. Celui qui donna une seconde vie au Duke dès la fin des Années Trente.
Le jeune Billy n’avait qu’un seul rêve, rencontrer son héros, le Duke en personne et lui montrer ses arrangements. Alors que le grand orchestre jouait dans sa ville (Pittsburgh), il eut l’opportunité, grâce à la complicité d’un ami commun, de forcer la porte de la loge du grand homme. Duke se reposait dans un sofa, entre deux sets. Il avait posé un loup sur ses yeux afin que le repos fût réparateur. Il y avait un piano dans la loge. Billy s’y installa et joua l’un de ses arrangements sur une composition du Duke. Il n’était pas au piano depuis plus que quelques instants que Duke, soudain ragaillardi, s’étant brusquement levé de sa couche, écoutait ébahi le jeune prodige debout devant le clavier. Un accord était scellé, ce qui entre deux pianistes est un peu habituel, et la collaboration entre les deux hommes, harmonieuse plutôt que harmonique, dura jusqu‘en 1967. Lorsque la barque de Billy, le cadet de Duke de seize années, accosta sur l’autre rive du fleuve de l’oubli, Duke lui consacra un album tout entier intitulé And his mother called him Billy.
Si j’insiste à ce point sur la figure finalement méconnue de Billy Strayhorn, auquel François Jeanneau rend hommage dans cet album à près de sept décennies de distance, c’est que le Duke ne lui a peut être pas porté la reconnaissance qu’il lui devait ; combien de fois s’est-il tourné vers lui, jetant quelques notes sur le piano en guise de thème, lui laissant le soin de faire le reste et s’arrogeant, lorsque le travail était achevé par son plus fidèle collaborateur, les droits d’auteur ? Toutes les compositions qui figurent dans cet album sont de Billy à l’exception de Come Sunday, signée Duke et partie intégrante de la suite Black, Brown and Beige.
François Jeanneau est indestructible. Aujourd’hui âgé de quatre-vingt-dix ans, il est l’un des pères fondateurs du jazz hexagonal, celui qui, avec d’autres, contribua à son émancipation vis-à-vis de l’encombrant modèle d’Outre-Atlantique. En outre, il fut un précurseur. Il fut le premier à s’intéresser au free jazz, il fut le premier chef de l’Orchestre National de Jazz, créé à l’époque de ce que d’aucuns appellent “Les années Lang”. Il fut l’un des seuls à avoir pu faire vivre une autre grande formation, le mythique Pandémonium. Il est le premier responsable de la section jazz du CNSM qu’il dirigea jusqu’en 2000. Il fut un expérimentateur infatigable, compositeur, arrangeur, poly-instrumentiste, capable de relever tous les solos ou presque de John Coltrane son idole, d’improviser des jours durant en trio avec ses amis Texier et Humair.
Il fut tout cela et d’autres choses encore. Aujourd’hui, apparemment retiré dans son jardin d’hiver, il nous adresse un message sibyllin :
« Je voudrais de la lumière…Comme en Nouvelle Angleterre
Je veux changer d’atmosphère …Dans mon jardin d’hiver »
Benjamin Biolay, Henri Salvador.
François Jeanneau éprouve, en effet, le besoin de revenir, au-delà de Billy, à la source du “fleuve Duke Ellington”, l’homme qui, trois-quarts de siècle durant, a incarné le jazz, lui, le Duke dont le père était major d’homme à la Maison Blanche. Et c’est magnifique, de chaleur humaine, de sensibilité à fleur de peau, de nostalgie pour des temps révolus, comme lorsqu’on regarde le fleuve couler du côté de Chelsea Bridge.
Points forts
Il faut bien comprendre que tous les morceaux qui figurent ici ont été composés et arrangés pour une grande formation. Il a fallu, par conséquent, les transcrire, c’est-à-dire, les réduire pour un duo soprano-piano. Le travail accompli est d’orfèvre. François Jeanneau se charge de la mélodie et les dix doigts du pianiste font le reste. Jeanneau prend visiblement un immense plaisir à jouer les thèmes, pour lesquels il a plein de tendresse et de respect à la fois. Je vais dire quelque chose qui peut paraître trivial à d’aucuns, mais les souffleurs qui me liront seront peut-être du même avis : Jeanneau joue parfaitement juste et cela n’est pas si aisé sur un saxophone soprano.
François Jeanneau atteint ici la quintessence de la musique. Il s’est débarrassé de tout le superflu, il va droit au but, straight ahead comme disent les Anglo-saxons : sonorité sublimissime, arabesques sonores, sobriété, et les dernières notes de chaque morceau, tenues et ténues comme un souffle qui s’éteint. Du grand art.
Entre les deux hommes, l'entente est parfaite. Il faut écouter la mise en place. Comment le tempo est parfaitement tenu et comment chacun retombe au centième de millimètre sur la mesure. Quant aux accords du pianiste, ils sont parfaits, jamais une fausse note, ni même une faute de goût.
Il n’est pas donné à tout le monde d’être un accompagnateur de génie, comme Gerald Moore auprès de Fischer-Dieskau. Emile Spanyi en fait partie, il écoute le soliste. Cela ne veut pas dire qu’il est servile, tout au contraire. Il ne prend pas systématiquement des solos. Il n’en a pas besoin, il a brillamment introduit le propos et il dialogue en permanence avec le soliste, enchaînant accords, accents stride (sur My brown book), arpèges et lignes mélodiques complètement improvisées qui surgissent de nulle part pour venir chuchoter à l’oreille du soliste.
Emil Spanyi, puisqu’il s’agit de lui, est un pianiste d’une rare et exquise élégance ; il sert merveilleusement la musique. En digne successeur des Tommy Flanagan, Jimmy Rowles ou Kenny Barron, ces pianistes dépourvus d’égo tellement appréciés des plus grands solistes. Il ne dédaigne pas, de temps à autre, les miroitements solaliens (de Martial Solal). Ce qui pour moi est le plus grand compliment que je puisse lui adresser. Je ne dis rien de son jeu, lorsqu’il utilise les claviers électroniques, et de la puissance de renouvellement qu’il imprime à tous ces morceaux qui sont devenus des standards depuis bien longtemps et auxquels il confère une actualité saisissante.
Quelques réserves
A de tels sommets, la blancheur de la neige est éblouissante, l’air se raréfie et on a du mal à suivre les marcheurs qui laissent les traces de leur pas dans la poudreuse. Donc, aucune réserve !
Encore un mot...
Take the A train a été composé par Strayhorn. Son titre fait référence à ce qu’il disait à ses amis lorsqu’ils lui rendaient visite à son domicile. Prenez la ligne A, en Français. Le morceau est tellement évocateur qu’il devint rapidement l’indicatif de l’orchestre jusqu’ en 1974, année de la mort du grand Duke.
Je vous recommande la version de Take the A train de nos compères. Elle commence par l’exposition du thème par François Jeanneau à deux reprises. Mais ce n’est qu’à la troisième tentative, c’est-à-dire le premier et seul chorus, que les voyageurs montent dans le train qui s’ébranle enfin jusqu’à prendre sa vitesse de croisière et filer au loin à toute vapeur s’échappant de la cheminée.
L'auteur
François Jeanneau est saxophoniste, flûtiste, claviériste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre. Au début des années soixante, il joue au club Saint-Germain avec George Arvanitas, Eddy Louiss, Martial Solal et Daniel Humair. Il participe à Free Jazz avec François Tusques. Au milieu des années soixante, il accompagne toutes les vedettes de variété et fonde un groupe de Pop Music à la vie éphémère : Triangle où il joue de la flûte. Il faut attendre 1975 pour qu’il enregistre son premier album en leader : Une bien curieuse planète. En 1978, il crée le grand orchestre Pandémonium dont il existera quatre moutures au moins.
Il joue en trio avec Texier et Humair. Les trois enregistreront ensemble deux albums et c’est une collaboration de plus de vingt ans. Il est l’un des sectateurs du Soundpainting, nouvelle gestique pour diriger un orchestre. Il dispensa sa science musicale immense auprès de plusieurs promotions du CNSM, dont il fut le fondateur de la section Jazz.
Emil Spanyi est d’un naturel tellement modeste qu’on peine à trouver sur lui une biographie digne de ce nom. D’origine hongroise, natif de Budapest, il fut élève au CNSM et eut Daniel Humair et François Jeanneau pour professeurs. Il a enregistré peu de disques dont un en duo avec un contrebassiste. On le retrouve aussi en quartet dans un CD paru sous le nom de Daniel Humair. Il est professeur au Pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt. Ses élèves ne tarissent pas d’éloges sur lui, à la fois en tant qu’enseignant et pianiste. On ne saurait les contredire, tout en regrettant que leur maître soit si discret sur la scène jazzistique.
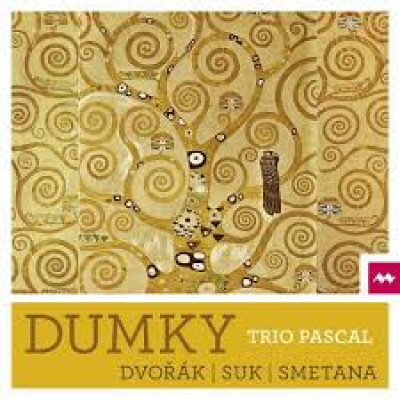
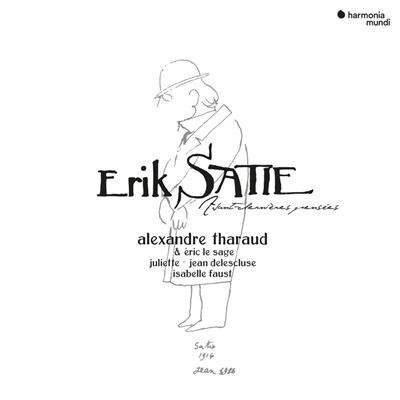
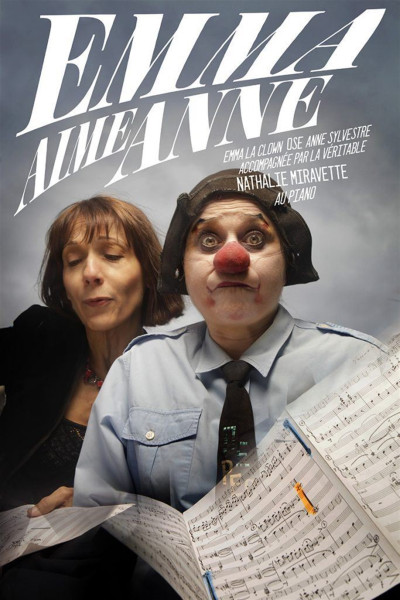
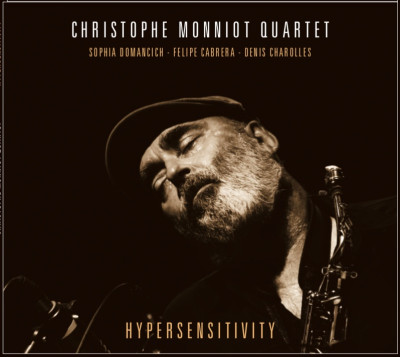
Commentaires
Un grand merci pour ce beau « reportage », il m’a fait un grand plaisir.
Avec Emil, nous allons rejouer tous ces morceaux de Strayhorn :
Samedi 1er novembre au Chorus de Lausanne et le 12 novembre à Paris au Sunside.
Merci encore.
François Jeanneau
Ajouter un commentaire