
Phèdre
Infos & réservation
Thème
A Trézène, ville du Péloponnèse, Phèdre, fille de Minos et de Pasiphaé, mais aussi jeune épouse de Thésée, est dévorée par un mal mystérieux dont elle refuse de dévoiler la cause. • Portée par son désir de mourir, elle vient voir pour la dernière fois le Soleil, dont sa mère se vantait de descendre. Sa nourrice, Oenone la conjure de se reprendre et de lui dire au moins ce qui la consume, et Phèdre avoue qu’elle aime Hippolyte, le fils d’un premier lit de Thésée. • Bientôt le bruit de la mort de Thésée se répand, ajoutant au drame sentimental et moral une dimension politique : qui va lui succéder ? Hippolyte ou le fils que Phèdre a eu avec Thésée ?
En proie au délire, Phèdre révèle ses coupables sentiments au jeune homme horrifié. Elle réclame la mort, et tandis qu'il reste sidéré, elle lui prend son épée pour s’en frapper. L’intervention d’Oenone l’empêche d’achever son geste.
Le retour de Thésée va précipiter le drame : Oenone conseille à Phèdre d'accuser Hippolyte d'avoir voulu la violer, l'épée qui est restée entre ses mains fournissant une preuve de la tentative. Phèdre repousse d'abord avec horreur une si odieuse perfidie.
Points forts
Apothéose d’un dispositif tragique ordonné par la passion, Phèdre est un absolu. Le rythme et la beauté des vers, la rigueur absolue d’une langue au vocabulaire simple et à la syntaxe complexe, emportent le spectateur.
La binarité des expressions, les balancements, les symétries, la juxtaposition de termes antinomiques et les assonances suggestives dessinent avec une précision d’orfèvre les impasses dans lesquelles les personnages sont enfermés, les contradictions qui les déchirent, l'effarement qui les saisit.
Concentrée sur les personnages de Phèdre, Oenone, Hyppolite et Thésée, la mise en scène élimine Aricie, Ismène, mêle le personnage de Théramène et celui de Panope, produisant un heureux resserrement sur les principaux protagonistes d’un drame, qui s’en trouve ainsi encore intensifié.
Dans un joli décor XVIIème siècle, le rougeoiement des tentures, des sols et du feu de cheminée, celui des costumes participe à la fureur qui transporte ces humains dépassés par leurs passions. Thésée, Oenone et Théramène, tous les trois de noir vêtus, ne sont pas plus mesurés que les autres, mais leur fournissent un contre-point qui a la couleur du raisonnement.
Les lumières très étudiées, toutes de clair-obscur et de contrastes saisissants, accentuent la pesanteur du drame intime dans lequel le spectateur est comme immergé.
Quelques réserves
Le texte n’est pourtant pas sans faiblesse : ainsi, l'interminable récit par Théramène de la mort d'Hippolyte, ainsi que les descriptions oiseuses du narrateur qui n’altèrent en rien l’invraisemblable patience et la tranquillité de Thésée, constituent une longueur objective de la pièce.
Le fameux effet de sourdine chez Racine aurait pu justifier une interprétation moins emphatique et plus murmurante de Phèdre, un pathétique plus maîtrisé. Mais c’est le choix du baroque qui a été fait ici, plus ornemental, accentuant les contrastes et les variations d’intensité et qui explique sans doute certaines scènes : celle du déshabillage puis du rhabillage, ou les contorsions de Phèdre découvrant qu’Hippolyte est capable d’aimer, mais qu’elle n’est pas l’élue.
On peut également discuter l’ajout des monologues explicatifs de Théramène - sorte de récitatif ou de chœur auquel le public est invité à participer - qui certes rappelle l’enracinement antique du drame mais leste le spectacle d’une sorte de pesanteur pas vraiment utile.
Encore un mot...
Tragédie « dont le sujet est pris d'Euripide » dit Racine, Phèdre est peut-être la plus racinienne des œuvres du poète. Ici, comme dans tant d’autres de ses pièces, le héros ou l’héroïne (qui ne sont jamais complètement des héros puisque leur âme est traversée de sentiments impurs) aime quelqu’un qui en aime un.e autre, dans une succession “cascadante“ qui finit toujours mal.
C’est que la passion est une destinée, l’effet de la colère des dieux, dont les humains ne sont ni complètement coupables ni totalement innocents. Certes, les valeurs sont bien chrétiennes, mais il n’est pas besoin de religion pour se sentir concerné par ces ambivalences et ces ambiguïtés.
Une phrase
Phèdre à Oenone :
« Quand tu sauras mon crime, et le sort qui m'accable,
Je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable.
(…)
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue.
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue.
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler,
Je sentis tout mon corps et transir, et brûler.
Je reconnus Vénus, et ses feux redoutables,
D'un sang qu'elle poursuit tourments inévitables.
(…)
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée :
C'est Vénus tout entière à sa proie attachée.
J'ai conçu pour mon crime une juste terreur.
J'ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur. »
Phèdre à Hippolyte :
« Et Phèdre au Labyrinthe avec vous descendue
Se serait avec vous retrouvée ou perdue. »
L'auteur
Né à la Ferté-Milon en 1639, Jean Racine est l'élève le plus illustre de Port-Royal. Mais ce janséniste austère, moraliste strict se brouille bientôt avec son ancien maître Pierre Nicole qui condamne le genre théâtral.
Depuis la fin des années 1660, il connait un succès éclatant et continu. Chacune de ses pièces est un triomphe : en 1671 Bérénice, en 1672 Bajazet, en 1673 Mithridate, en 1674 Iphigénie en Aulide.
En 1673 il est élu à l'Académie française, et en 1677 Phèdre, une de ses huit pièces antiques, est donnée au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, le 1er janvier. Comme pour chacune de ses pièces, une cabale est orchestrée contre le poète. Cette fois c’est la duchesse de Bouillon, une nièce de Mazarin, qui lui oppose la Phèdre de Pradon, pièce médiocre. La manoeuvre ne l’empêche pas de triompher à nouveau, puisqu’il devient la même année, avec Boileau, historiographe du roi, lequel lui octroie en outre une gratification exceptionnelle de 6 000 livres.
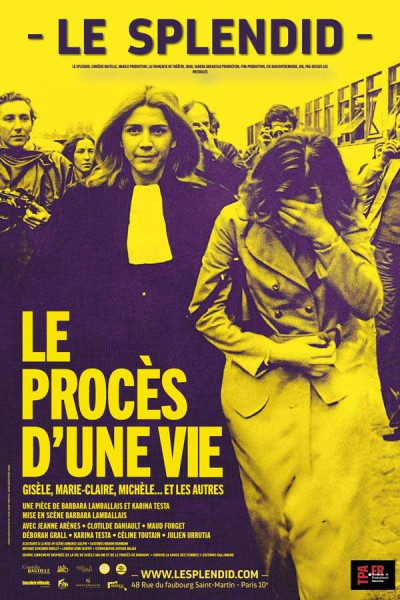
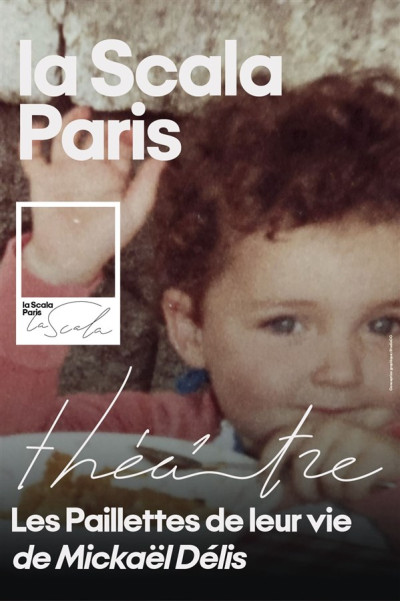
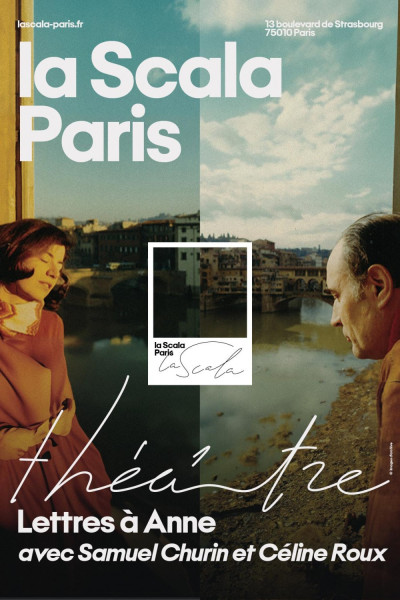
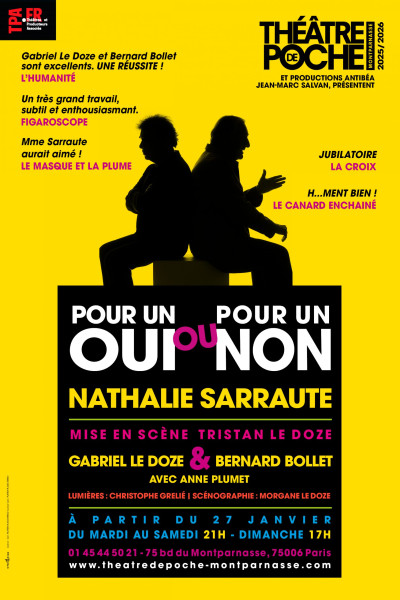
Ajouter un commentaire