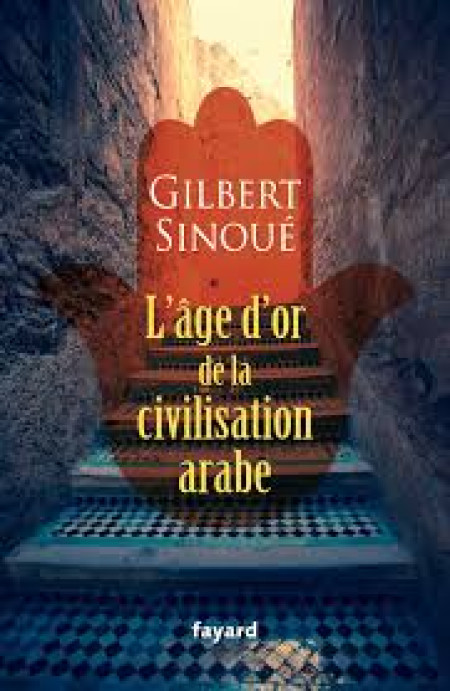
L’Âge d’or de la civilisation arabe
Publication le 2 avril 2025
349 pages
22,90 €
Infos & réservation
Thème
Nous savons depuis Paul Valéry que les civilisations sont mortelles. Et même lorsqu’elles ne disparaissent pas, elles connaissent une alternance de périodes de faste où tout semble converger - puissance militaire et économique, production scientifique, création artistique - et de phases de décadence où l’on assiste au rabaissement politique voire à la colonisation étrangère, à l’obscurantisme et au déclin culturel. Tout n’est d’ailleurs pas lié et certains moments d’effacement, de troubles ou de fin de cycle peuvent néanmoins être marqués par une floraison picturale, musicale ou littéraire, et inversement.
Gilbert Sinoué entreprend d’évoquer ce qu’il nomme l’âge d’or d’une de ces civilisations apparue au VIIème siècle avec la prédication du prophète Mohammad et la fulgurante expansion, de la péninsule arabique à l’Espagne, d’un peuple de bédouins parvenu à la tête d’un immense empire aux merveilleuses capitales, Bagdad, Damas ou Cordoue.
D’emblée, il explique son choix de civilisation arabe et non musulmane, ce qui peut se discuter car c’est incontestablement l’Islam qui constitue le point essentiel, même si les trois religions monothéistes ont cohabité dans ce vaste ensemble ; de plus un certain nombre des protagonistes de cet âge d’or ne sont pas arabes mais berbères, persans, ou issus de communautés chrétiennes converties. Mais il est vrai que c’est la langue arabe, vecteur du Coran, qui a constitué le ciment de cette civilisation.
Le livre se décompose en quatre parties inégales : Survol (un rapide panorama historique de la naissance du Prophète en 570 à la chute de Grenade en 1492), puis Passeurs de lumière et innovateurs, Les maîtres, Les autres phares (trois chapitres de biographies de nombreux savants, astronomes, médecins, philosophes, écrivains, voyageurs… ayant illustré cette riche période).
Points forts
Gilbert Sinoué déploie une érudition impressionnante quant à la connaissance des grandes figures de cette histoire.
Le lecteur apprendra que le mot algorithme, si à la mode aujourd’hui, vient du mathématicien Al-Khwârizmî, quel est l’apport du célèbre Avicenne à la médecine moderne, d’où vient le chiffre zéro, comment les astronomes arabes ont calculé la circonférence de la Terre avec une erreur infime, etc…
De plus, en raison de sa double appartenance (sa naissance égyptienne et le fait qu’il vive en Occident et écrive en langue française) on sent l’auteur passionné par son sujet et investi d’une sorte de mission, consistant, dit-il lui-même, moins à intéresser le lecteur occidental que de convaincre le jeune lecteur arabe à se souvenir de l’ouverture d’esprit de ses ancêtres « qui ne ressemblent en rien à ceux qui, de nos jours, persistent à consulter l’heure sur des montres arrêtées ».
Autrement dit, il s’agit d’un acte militant revendiqué contre la tendance actuelle de retour au passé dans ce qu’il a de plus sclérosant et opposé à tout progrès ; en cela sa sincérité n’est pas contestable.
Quelques réserves
Pour autant, on se permettra d’avancer des objections, sur la forme comme sur le fond.
Sur la forme : au milieu de cette morne compilation de notices biographiques qui fait tout de même 205 pages, soit près des deux tiers de l’ouvrage, on est hélas à mille lieux du souffle grandiose qui nous submerge à la visite de l’Alhambra de Grenade ou de la Mosquée de Cordoue…
Le cruel mot de Voltaire sur le genre ennuyeux nous vient à l’esprit, perdus que nous sommes dans cette litanie de noms alignés sans ordre, qu’il soit chronologique, alphabétique ou par spécialité, entre Al Sheikh al-Akbar, Muhyî al-dîn Abû ‘Abdallah Mohammad ibn ‘Ali ibn Mohammad ibn ‘Abdallah ibn al-‘Arabî al-Tài al-Hâtimî at-trâ’i ibn al-Arabi al-Andalusi (1165-1240) et Ala al-Din Abû al-Hassan Ali ibn Abî al-Hazm al Qurashî al-Dimaskqî, connu sous le nom d' Ibn al-Nafis (1210 (?)-1288)…Sur le fond : ce plaidoyer pro domo est le prétexte pour s’inscrire dans une polémique maintenant ancienne puisqu’elle remonte à 2008 et la parution du livre de l’historien français Sylvain Gouguenheim intitulé Aristote au Mont Saint Michel, lequel contestait l’apport des Arabes à la redécouverte de la philosophie grecque. Ce type de controverse dont le microcosme universitaire a le secret s’alimente à coup d’arguments d’autorité mais nous paraît assez vain, surtout comme en l’espèce où la pensée de Régine Pernoud sur le Moyen-Âge se voit radicalement déformée, de même nous semble-t-il que celle d’Ernest Renan.
Comment se fait-il que dès qu’il s’agit de cette partie du monde, la raison doive céder la place aux passions politiques et religieuses ? Certes Gilbert Sinoué est trop fin pour employer le mot d’islamophobie mais d’autres contempteurs du livre détesté ont allègrement franchi ce pas (à commencer par l’incontournable Patrick Boucheron).
Encore un mot...
Il est dommage que ce livre passe en définitive à côté du vrai sujet qui est : pourquoi cet âge d’or a-t-il pris fin, et pourquoi cette civilisation si avancée s’est-elle trouvée tout-à-coup entravée dans son progrès pour en arriver - dans son aspect le plus extrême qui n’est bien sûr pas général - à l’intégrisme des Talibans ? De ceci il n’est à aucun moment question, alors que l’auteur, son introduction le prouve, est le premier à le déplorer.
Et que dire de la solution proposée pour y remédier ? Le livre s’ouvre sur un hommage déférent au cheikh Zayed ben Sultan al-Nahyane, fondateur des Emirats Arabes Unis, qui a ouvert des écoles, des musées, des hôpitaux ; fort bien. Dubaï, ses gratte-ciels bling bling, les potentats pétroliers et l’absence de démocratie, espoir d’un nouvel âge d’or du monde arabo-musulman ? On se permettra d’être sceptique.
Une phrase
« Que dire ? Sinon que la liste est longue des partisans de cette méthode qui consiste à minimiser, voire à gommer l’apport de la civilisation arabo-musulmane à l’Occident. Disons-le, ce sont des raisonnements pour le moins extravagants. Tout aussi extravagant est d’affirmer que la civilisation arabe ne fut « qu’une courroie de transmission ». Comme si ce seul fait était banal, et dépourvu d’intérêt. Transmettre son savoir, ses acquis, n’est-ce pas l’essence même, la clef de voûte de tout progrès ? N’est-ce pas grâce à cette « transmission » que le trésor antique est arrivé jusqu’à nous et a contribué à faire ceux que nous sommes ? » (p. 94)
L'auteur
Gilbert Sinoué est né au Caire (Egypte) en 1947 dans une famille chrétienne de rite grec. Après une première carrière de parolier de chansons à succès pour Claude François, Sheila ou Dalida, il s’oriente à partir de 1985 vers l’écriture de romans historiques évoquant des figures du monde oriental (Avicenne ou la route d’Ispahan. Denoël,1989 ; Averroès ou le secrétaire du diable. Fayard, 2018), des pays du Proche Orient (l’Egyptienne. Denoël, 1991); Le Dernier Pharaon. Gallimard 2011), l’Espagne musulmane (le Livre de Saphir. Denoël, 2004 ) ou plus récemment le Maroc (Au couchant, l’Espérance. Gallimard, 2025).
Sur Culture-Tops :
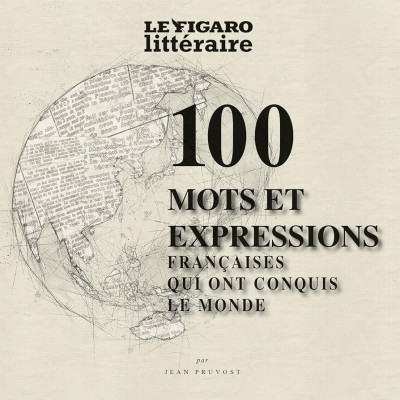
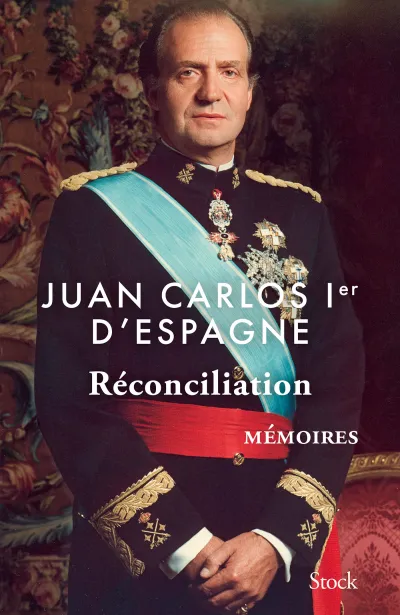

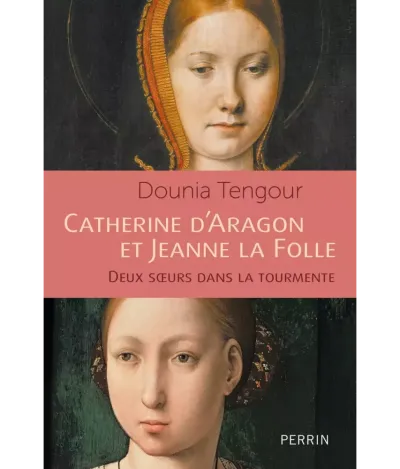
Ajouter un commentaire