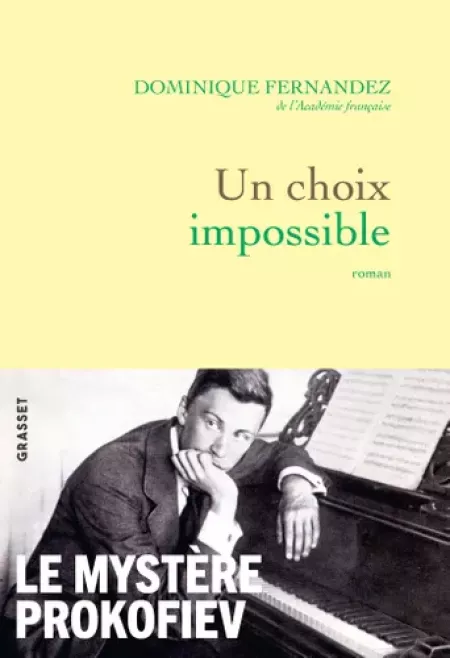
Un choix impossible. Le mystère Prokofiev
Publication le 2 avril 2025
544 pages
25 €
Infos & réservation
Thème
C’est à un compositeur, et parmi les tout premiers du 20ème siècle en la personne de Serge Prokofiev, que Dominique Fernandez a consacré son dernier opus sobrement intitulé Un choix impossible, livre volumineux de plus de cinq-cents pages. “Titre impossible” serions-nous tentés de dire à notre tour, tant la complexité des situations rencontrées par le natif de Sontsovka, dans le bassin du Donets, quelque part en Ukraine, ne saurait être ramassée en trois mots. Mais n’est-ce pas là le propre de la plupart des titres dans leur difficulté parménidienne de dire le plus avec le moins ?
“Un choix impossible”, donc : expression résumant en son masculin singulier des problématiques plurielles qu’il lui a fallu résoudre en des circonstances particulièrement cruciales de son existence mêlant tout à fois fidélité à une histoire familiale, volonté de s’en émanciper par l’affirmation de sa propre vocation artistique et recherche des conditions matérielles les plus favorables à l’épanouissement de son génie. Bref, une odyssée personnelle intimement liée aux soubresauts de l’Histoire où enjeux esthétiques (comment ne pas renier la tradition populaire russe héritée de Glinka, Borodine, Moussorgski et Tchaïkovski et trouver son propre chemin vers la modernité ?) et politiques (comment ne pas trahir sa patrie en la quittant pour, à la fois, être au plus près des promoteurs des nouvelles techniques compositionnelles et pour assurer la sécurité des siens avant de faire retour à son pays d’origine au prix de compromissions aussitôt haïes que acceptées ?) ne cessèrent de s’entremêler pour s’imposer à une conscience musicale parmi les plus affirmée du 20ème siècle.
Points forts
Très peu de dialogues pour nous raconter cette aventure emblématique de l’époque où le camarade Staline pouvait corriger directement le texte d’une cantate afin qu’elle eût l’heur de conforter son projet totalitaire. Prokofiev, héros du récit, n’est jamais en première ligne pour s’exprimer, Fernandez recourant à l’artifice littéraire consistant à faire raconter la vie du musicien par son ami d’enfance Igor. C’est donc celui-ci qui, au crépuscule de son existence, nous parle de Prokofiev comme de son frère jumeau dont il a intimement partagé la plupart des moments décisifs de l’existence faite aussi bien de triomphes sur la scène musicale internationale que de profond abattement face au réseau de contradictions inextricables auxquelles il a dû faire face.
Quand le jeune Serge s’affirme, la modernité se cherche : elle s’appelle Richard Strauss, Maurice Ravel, Arnold Schoenberg suivis bientôt d’Alban Berg et de Webern. Un certain Stravinski y a également sa part, célébré en Occident depuis une mémorable soirée de 1913 qui vit éclore le printemps en son Sacre. Désireux d’explorer de nouveaux chemins, Prokofiev, pianiste adulé pour avoir mis en valeur les capacités percussives de son instrument, souhaite se rapprocher des principaux acteurs de la révolution musicale à l’œuvre : ce sera sa période européenne qui durera quelques années, de 1918 à 1936, et verra l’éclosion de quelques partitions phares.
Critiqué en Union soviétique pour avoir délaissé, pour ne pas dire trahi, sa patrie, il sera rongé d’un remords tenace qui, finalement, aura raison de son tropisme européen. La mémoire imprégnée des souvenirs de son passé russe l’incitera à retrouver le pays de son enfance dès 1936, pour le meilleur et pour le pire. Certes sa collaboration avec Eisenstein produira des pages immortelles mais les autorités sauront aussi lui faire comprendre qu’il ne saurait avoir les coudées franches, l’obligeant à se compromettre avec un régime honni afin d’assurer un minimum de sécurité pour les siens, comme durent le faire aussi Chostakovitch ou Khatchatourian.
De cette compromission forcée, naquirent des pages d’une médiocrité certaine (notamment une Ode à Staline en 1950) afin de complaire au grand inquisiteur Jdanov, alternant avec de somptueuses partitions (en particulier certaines de ses symphonies ainsi que le ballet Roméo et Juliette). Ainsi fut-il stigmatisé des deux côtés en même temps : par l’URSS comme agent de l’étranger dénaturant la culture populaire russe au profit d’une « esthétique formaliste » et par les milieux occidentaux pour servilité envers Staline - double accusation dont il ne se remit jamais face au choix impossible qui lui fut imposé. Prokofiev décéda quelques minutes avant Staline et fut inhumé sans cérémonie, et presque en catimini à Moscou en 1953, non loin de la dernière demeure de Scriabine ; David Oïstrakh joua sur sa tombe le premier mouvement de sa Première sonate pour violon et piano célébrant ainsi une forme de retour aux origines de l’un des plus grands pianiste et compositeur de la première moitié du 20ème siècle.
Quelques réserves
On aurait apprécié que l’auteur fouille davantage les relations de Prokofiev avec Poulenc qui fut sans doute le compositeur « occidental » le plus proche de lui, et avec Stravinski dont il jalousa les succès précoces.
Encore un mot...
Parmi les innombrables enregistrements des œuvres du compositeur, on saura gré à Dominique Fernandez d’avoir proposé en fin de volume une sélection d’interprètes et d’orchestres russes, histoire de rester dans le bain de culture originel de Prokofiev.
Une phrase
« C’est une profonde erreur de prendre toute complication pour un progrès. De même en musique, une symphonie, un concerto dont l’auteur semble ignorer les émotions humaines normales, une sonate qui ébranle le psychisme et attaque le système nerveux, ne peuvent être considérés comme utiles à la société. Si les hyènes savaient se servir d’une plume et les chacals d’une feuille de papier à musique, ils écriraient comme Stravinski ». P 484 (Extrait d’un discours de Jdanov (1948) cité par l’auteur.)
L'auteur
Qui ne connaît Dominique Fernandez - membre de l’Académie française - et sa très longue bibliographie ? Depuis maintenant plus d’un demi-siècle qu’il nous gratifie de ses romans, essais sur la peinture et l’architecture, traductions, livres de voyage et de photographies, il est opportunément installé dans le confort des bibliothèques de tous ceux pour lesquels la chose écrite revêt une importance certaine. La fréquentation de cet ami qui vous veut du bien est des plus précieuses et a la saveur des compagnonnages qui font discrètement partie de votre vie. Pour nous avoir dit son amour de l’Italie, de la Méditerranée, de l’Europe baroque et entretenu de ses errances solaires qui lui ont fait éprouver les émotions esthétiques les plus précieuses aux quatre coins du monde, il fait définitivement partie de l’imaginaire français, fidèle en cela à la vocation à l’universel d’un pays dont l’histoire littéraire montre assez les multiples emprunts et sources d’inspiration hors de ses frontières. Son Prokofiev se situe dans la lignée de ses grands romans consacrés à Pasolini (Dans la main de l’ange, prix Goncourt 1982), Tchaïkovski (Tribunal d’honneur, 1997), Le Caravage (La Course à l’abîme, 2002), Bronzino (La Société du mystère, 2017), Picasso (Le Peintre abandonné, 2019).
A lire sur Culture-Tops, le précédent roman, paru en 2024, de Dominique Fernandez :
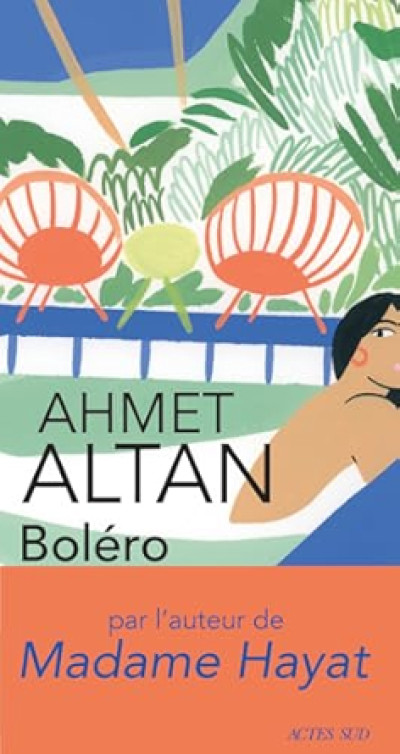
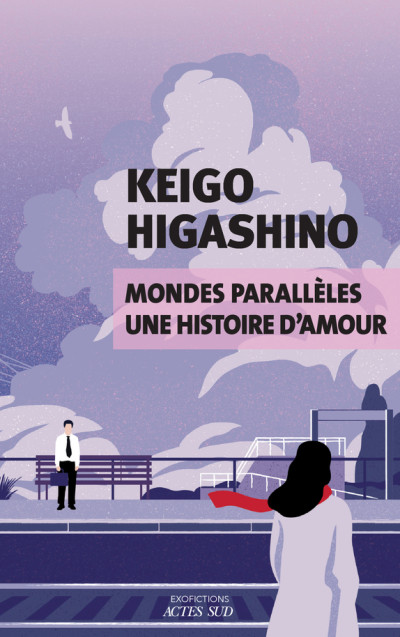
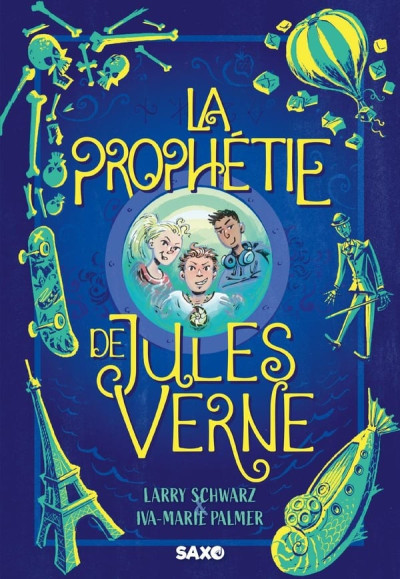
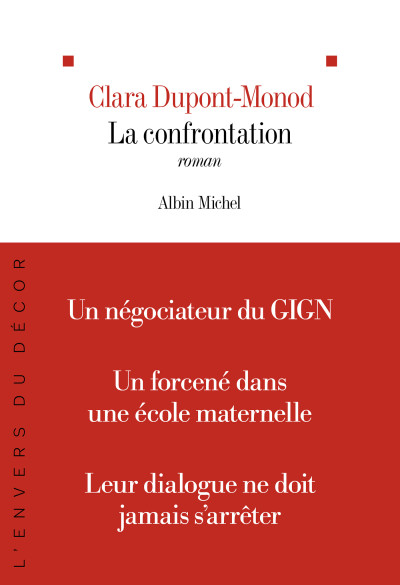
Ajouter un commentaire