
Ma vie avec Apollinaire
160 pages -
16 euros.
Infos & réservation
Thème
La crise sanitaire actuelle en rappelle d’autres, souvent pires. Ici, l’épidémie du coronavirus fait écho à celle de la grippe espagnole que le Gouvernement de l’époque, la boucherie de 14-18 à peine achevée, décida dans un premier temps de “gérer” sans rien faire. Guillaume Apollinaire a succombé à cette maladie à la mode le 9 novembre 1918. François Sureau sait bien des détails de sa mort. Il connaît l’existence du poète du mieux qu’il peut, selon ce qu’il a choisi de garder en lui, de son enfance chaotique au costume qu’on lui mit pour son enterrement, de la taille de sa bouche à la marque de sa pipe, de ses amours véritables à ses fausses amitiés. “Guillaume” l’a accompagné toute sa vie.
C’est un poète “mal-aimé”, toujours désargenté, vivant tantôt dans les fulgurances, tantôt dans les souvenirs, la mélancolie ou la déception. Les femmes qu’il aime sont libres, exigeantes, infidèles et se détachent de lui. Sa mère vit en-dehors du monde, il ne sait pratiquement rien de son père. Il s’inscrit dans la discipline la plus stricte ou l’errance la plus incertaine. “Des écrits érotiques lui valurent d’être exclu du collège”. Il s’engage dans l’armée, s’enferme dans le travail, écrit encore et encore. Il cherche “la consécration classique” mais aime “la vie dans les marges”, rêve d’être élu à l’Académie française mais veut “rester une sorte d’anarchiste”. On découvre ce poète pour de bon, intimement, par la fascination qu’il exerce sur l’auteur de ce livre, à travers les correspondances qu’il sème, par petites touches, entre la vie d’Apollinaire et sa propre vie.
Points forts
- Une fois qu’on a décidé de s’y plonger, ce texte curieux, pénétré de nostalgie et d’amour, est prenant. Sa structure déroutante, déséquilibrée, les obscurs titres de ses chapitres tirés des vers d’Apollinaire constituent un chemin tortueux et donnent un plaisir certain à sa lecture. De temps à autre, un passage fleure bon la déprime, pour ne pas dire le chagrin et l’incohérence. Mais ce texte, tantôt sombre et complexe, tantôt précis et lumineux comme un tableau pointilliste, fourmille d’anecdotes, de noms très connus ou beaucoup moins, d’œuvres célèbres ou injustement oubliées. Félix Fénéon, André Salmon, Mécislas Goldberg côtoient Picasso, Alfred Jarry ou Marie Laurencin. On se surprendra à chercher à lire des romans oubliés comme Le Nouveau Maître d’école ou Mademoiselle Mignonne de Ponson du Terrail, auteur qui revit, parmi tant d’autres, au détour d’une page.
- Cet amour pour Apollinaire, poète éternel et disparu, est fascinant parce qu’il semble résister à toute chose. Parfois, ceux que nous avons aimés en chair et en os nous ont sauvés malgré eux des affres de la passion parce qu’ils ont eu l’occasion de se montrer décevants. Un jour, nous leur avons découvert un manquement quelconque, une sorte de discontinuité qui nous a décidés à nous éloigner d’eux. Il n’en est pas de même pour ceux que nous n’avons pas connus directement et que nous avons décidé d’aimer quand même ou d’aimer pour cette raison. Ceux-là sont intouchables et invincibles. L’auteur retrouve des lettres, des témoignages propres à ternir l’image qu’il s’est faite du poète. Mais, ainsi qu’il en serait pour quelque parent imparfait, les défauts qu’il lui trouve sont inaudibles quand ils sont formulés par d’autres. Il n’hésite pas à rendre la monnaie de leur pièce à ceux qui critiquent un peu trop Apollinaire. Une ou deux piques sortent, çà et là, sur une maîtresse ingrate ou un ami désobligeant. Voilà plus de cent ans que Guillaume Apollinaire est mort, mais ce livre réveille son souvenir en douceur et, sans être parfait, le poète y est intact, comme le serait la Belle au Bois Dormant.
- On apprécie toujours la justesse des peintures d’une réalité qu’on connaît ou qu’on a connue par personne interposée. Aussi faut-il le dire : la description de l’armée comme une échappatoire théâtrale qui embrasse par sa discipline tant de rêves romantiques et désordonnés, un danger réel en temps de guerre qui “côtoie encore la mort” en temps de paix, un amas de règles strictes qu’on peut contourner plus qu’ailleurs est assez remarquable. Quiconque a déjà entrevu la vie de caserne et ceux qui la faisaient sait à quel point le monde civil semble parfois, par contraste, dur et effrayant. Plus largement, quiconque a décidé d’accomplir une chose dangereuse aux yeux du commun des mortels pour fuir une réalité personnelle plus périlleuse peut comprendre cette phrase : “Je me suis engagé par trouille”.
- L’auteur devient lui-même, dans ce livre, plus encore que dans les précédents, un personnage fascinant et paradoxal. Peut-être parce qu’il est désormais à la mode de l’aimer, ce qui lui crée fatalement un problème. Cette adulation nouvelle se ressent peut-être dans son écriture, comme si ce succès recherché lui était finalement pénible. Car l’amour, d’abord inespéré, “cesse immédiatement d’être une surprise” et risque de devenir un fardeau, surtout pour un écrivain. Il semble vouloir s’en débarrasser. Alors il décrète, en quelque sorte, que l’amour qu’on lui porte n’existe pas ou qu’il ne tient qu’à la médiocrité de l’époque. Comment pourrait-il autrement continuer d’écrire ? Être mal aimé, ou avoir le sentiment de l’être, est bien évidemment une arme de création, François Sureau ne dit pas autre chose. Et cet état qu’il semble recréer de toutes ses forces pour écrire l’a de toute évidence inspiré.
Quelques réserves
Ponctuellement, on cesse d’adhérer à la nostalgie du texte, surtout lorsqu’elle est mise en perspective avec l’actualité. La fin du livre, par exemple, qui vient fustiger les temps troublés que nous vivons, donne l’impression d’acter le regret pur et simple de l’époque d’Apollinaire, même si l’auteur s’en défend. C’est en tout cas ce que l’on peut ressentir, à tort ou à raison. Il n’est pas question d’ignorer nos manques, nos fatigues ou les erreurs commises par ceux qui nous gouvernent. Mais présenter l’époque actuelle en France comme celle où “le monde a disparu”, quand on pense à ce qu’était ce monde au siècle dernier, avec ses guerres, sa peine de mort, son bagne, son droit de vote réservé aux hommes et d’autres choses encore, est difficilement compréhensible.
Encore un mot...
Une élégie qui ressemble à un conte de fée.
Une phrase
“À l’armée, les rêves ne sont pas facilement communicables ; et l’on est pris dans cette grande machine paradoxale qui, mélangeant dans son fourneau les symboles et les réalités ordinaires, se sert des émotions les plus intimes, des vertus les plus personnelles – la peur, le courage, le sens de l’honneur, le souci de ne pas décevoir – pour fabriquer le pur instrument de l’État, cet homme en lequel s’effacent les frontières entre la vie intérieure et l’engagement public. Une frontière invisible sépare ceux qui ont fait cette expérience de ceux qui ne l’ont pas faite. Cela n’a pas à voir avec la valeur ou les qualités de chacun. Si l’on en tire un bénéfice, c’est celui d’une épreuve, non d’un enrichissement – bien au contraire. C’est une sorte de dépucelage, aux effets d’autant plus imprévus qu’il n’était pas nécessaire – sauf pour ceux qui avaient cette vocation-là – et que, sitôt l’action venue, son caractère d’absurdité apparaît assez vite. On se donnera toutes les raisons du monde ; le patriotisme, la politique en premier lieu. Ces raisons ne sont que du bois jeté dans la machine à marcher, à mourir. Elles ne pèsent jamais le même poids que la crainte, la fatigue, le drap de l’uniforme anonyme mouillé par les pluies, que cette tunique de la douleur que l’on ne peut enlever”. (pp. 50-51).
L'auteur
François Sureau, né en 1957, membre de l’Académie Française, a notamment étudié à l’Institut d’Études Politiques de Paris et à l’ENA. Dans les années 1980, il a été membre du Conseil d’État, période qui lui a inspiré son récit Le Chemin des morts (Gallimard,2013).
Il a ensuite exercé la profession d’avocat, cofondé l’association Pierre Claver, qui vient en aide aux réfugiés, écrit des chroniques, des essais, des tribunes, des romans et des poèmes. Il a publié en tout une trentaine d’ouvrages, dont L’Infortune (1990), L’obéissance (2007), Inigo (2010), Sans bruit sans trace (2011), Je ne pense plus voyager (2016), Sans la Liberté (2019), L’Or du temps (2020). Tous les livres cités ci-dessus sont édités chez Gallimard.
Et Pour la Liberté (Tallandier, 2017).
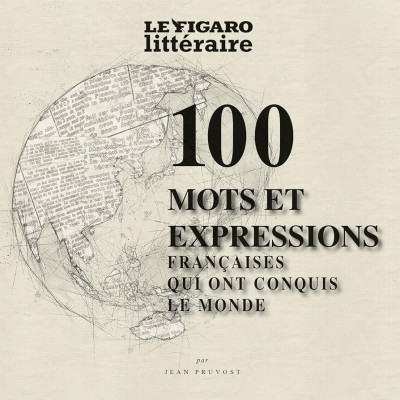
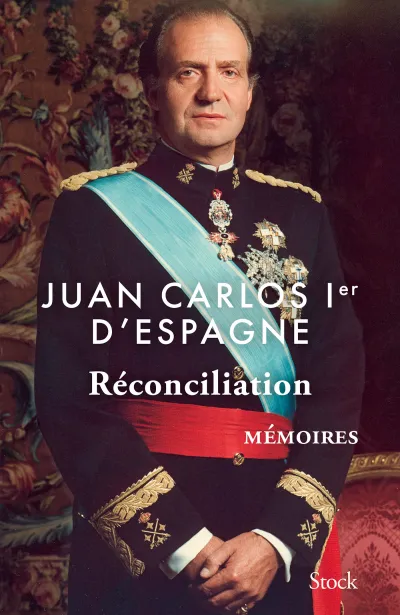

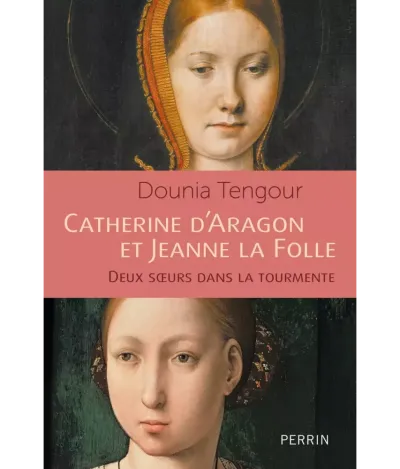
Commentaires
Merci pour cette chronique excellente et fouillée qui dépeint bien l’expectative dans laquelle nous plonge Sureau. Entre ennui ( même si vous n’osez pas le
dire ! ) et fascination pour une culture à la hauteur de l’inculture de la majorité de ses lecteurs car, comme vous le dites si bien, il est à la mode de l’aimer…
Le tour de force c’est que c’est du Sureau avant d’être Apollinaire.
( Voyez ma chronique de " L’or du temps" )
Ajouter un commentaire