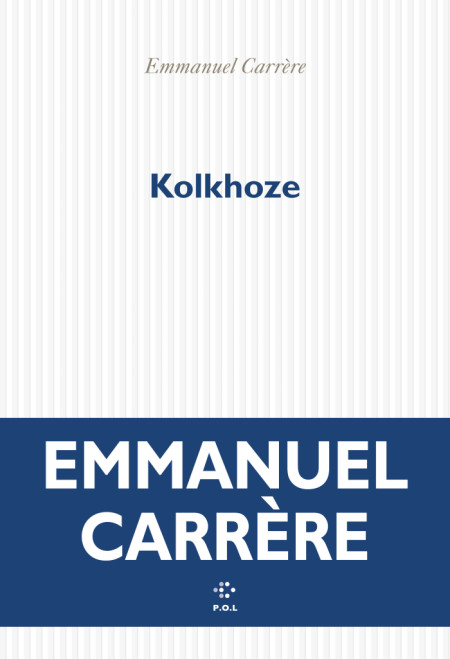
Kolkhoze
Septembre 2025
558 pages
24 €
Infos & réservation
Thème
Le voici donc, le livre événement de cette rentrée littéraire, annoncé à grands sons de trompe et promis aux plus hautes récompenses, déjà en tête des ventes…
Il s’agit, à partir de la mort de la mère de l’auteur, Hélène Carrère d’Encausse née Zourabichvili (1929-2023), historienne, spécialiste du monde soviétique puis russe, secrétaire perpétuelle de l’Académie française, de reconstituer l’épopée de sa famille du début du XXème siècle à aujourd’hui. Récit familial donc à la matière riche puisque les branches de l’arbre généalogique s’entremêlent : géorgienne, germano-russe, celle-ci issue de la plus haute aristocratie balayée par la Révolution et contrainte à l’exil parisien.
C’est l’histoire d’une petite fille apatride, démarrant mal dans la vie car pauvre et fille d’un homme exécuté à la Libération dans des circonstances jamais élucidées pour des faits de collaboration eux aussi largement inconnus, puis connaissant une célébrité médiatique et officielle culminant dans des obsèques nationales aux Invalides. C’est aussi l’histoire de son mari, plus roturier en dépit d’une particule d’ailleurs usurpée, demeurant durant 70 ans dans l’ombre au prix d’avanies et de renoncements pathétiques.
C’est la propre vie de l’auteur jusqu’au déclenchement de la guerre d’Ukraine, vécue en direct à Moscou. C’est enfin une tranche de l’Histoire de la France, de la Géorgie, de la Russie, de l’Europe, sur un siècle à travers le prisme de cette famille pas comme les autres.
Points forts
Emmanuel Carrère a le don de trouver des sujets : qui d’autre a eu l’idée d’écrire sur les juges d’instance traitant d’affaires de surendettement (D’autres vies que la mienne), sur un voyou russe entré en littérature puis en politique dans les rangs extrémistes (Limonov) ? Et quand il s’attaque à une biographie c’est celle de Philip K. Dick, choix là encore audacieux.
Ici, si le récit familial est moins original (c’est un genre littéraire à lui seul), il le rend intéressant du début à la fin, servi en cela par le caractère hors normes de sa branche maternelle.
On aime aussi les petites madeleines que sont les anecdotes de la vie d’un jeune garçon dans les années soixante (nous avons presque le même âge) : le fossé à l’école entre ceux dont les parents ont la télé et ceux qui ne l’ont pas, le cérémonial des vacances (ne jamais se baigner moins de deux heures après avoir déjeuné), la vie de famille en apparence si banale, même si l’on se rend compte assez vite que tout ne tourne pas aussi rond que l’image bien lisse qu’on en donne...
L’exercice de « piété filiale » revendiqué ne tourne jamais à l’hagiographie. Au contraire, Emmanuel Carrère procède à un rigoureux devoir d’inventaire, quitte à rouvrir des plaies mal cicatrisées : le passé collabo du grand-père, les fréquentations sulfureuses de l’Après-guerre, les erreurs manifestes commises par la grande spécialiste, que ce soit sur le processus de chute de l’URSS, le rôle d’Eltsine, l’invasion de l’Ukraine. On a même l’impression qu’Hélène Carrère d’Encausse tirait sa légitimité toujours plus forte du fait qu’elle se trompait, ce qui est une caractéristique commune à bien des intellectuels français.
Qualifier sa mère, non pas d’historienne de l’Union Soviétique mais d’«historienne soviétique», voulant ainsi définir son rapport à la vérité, est osé mais salutaire. Cela n’empêche pas l’expression d’un amour véritable et d’une grande tendresse, et nous défions toute personne normalement constituée de ne pas être émue à la lecture des derniers chapitres.
Quelques réserves
Emmanuel Carrère n’est pas Marguerite Yourcenar à laquelle le projet peut faire penser (il en parle d’ailleurs pour dire qu’il est moins ambitieux, en tous cas sur la période traitée). Son style est assez pauvre, et même de temps à autres un peu relâché : des redites, un usage du passé composé moins élégant selon nous que la combinaison imparfait / passé simple.
Par ailleurs, on peut ressentir une certaine gêne devant la mention de détails intimes, l’auteur ne s’arrêtant pas à la porte de la chambre à coucher – expression à prendre ici au sens propre. La position du voyeur est inconfortable et la sensation de participer à une séance de thérapie géante peut troubler.
Mais encore une fois, ces quelques objections sont peu de choses au regard d’un texte toujours passionnant et qui se transcende à la fin dans des pages admirables.
Encore un mot...
La présence de ce livre dans la liste de sélection du Goncourt peut interroger ; ce prix n’est-il pas réservé à un roman, donc à une œuvre de fiction, ce qu’il n’est en aucun cas. Pour autant, le traitement de son sujet, pour ne pas dire le sujet lui-même, renvoie au monde romanesque et il est permis de dire que Kolkhoze est un roman comme le sont les Mémoires de Saint-Simon, à ce détail près que les personnages y portent leur nom véritable. Cette référence n’est d’ailleurs pas gratuite, ne serait-ce qu’en raison de la place accordée aux généalogies et de l’art du portrait qui se déploie au fil des pages (d’une méchanceté jubilatoire : voir Michel Baroin ou Jean Dutourd habillés pour l’hiver).
La figure trouble du grand-père maternel dans le contexte de l’Occupation, nous évoque quant à elle l’univers de Modiano.
Et puisqu’il est souvent parlé de Dostoïevski et de Tolstoï, évoquons le premier pour dire que le père, sorte de Duc d’Edimbourg mélancolique est L’Eternel Mari ; et s’agissant du second, comment ne pas avoir en tête le fameux incipit d’Anna Karénine qui pourrait résumer tout le livre : « Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses le sont chacune à leur façon ».
Une phrase
« Mon grand-père, Georges Zourabichvili, a vécu en paria et est mort en paria. Il n’a jamais trouvé de place dans la société française. Il s’y sentait invisible, négligeable – comme un immigré arabe de la première génération dont il avait le teint mat, la petite moustache, la fierté bafouée. Quand il prenait le métro avec sa fille, il aurait voulu lui montrer un visage glorieux, pas celui d’un pauvre homme noyé dans la foule, qui porte des vêtements de pauvre et ne peut payer que des vêtements de pauvre à ses enfants. Assise à côté de lui, la petite Hélène serrait fort sa main pour le consoler, lui dire qu’à ses yeux au moins il était un homme puissant, un homme que les autres regardent et ne bousculent pas sans le voir. Cette scène, que j’ai racontée dans Un roman russe, je crois qu’elle est la vérité de ma mère. Elle est le noyau de tout ce qu’elle a été, de tout ce qu’elle a fait, de sa spectaculaire ascension de petite fille apatride jusqu’au sommet de la société française. » (p.347-348)
L'auteur
Emmanuel Carrère est né en 1957. Il a débuté comme critique de cinéma puis a publié plusieurs romans (La Moustache 1986, La Classe de neige 1995). Puis il cesse d’écrire des œuvres de fiction au profit de récits tirés de faits réels : affaire criminelle dans L’Adversaire (2000), histoire familiale (Un roman russe 2007), histoires de personnes ayant croisé sa propre vie à l’occasion du tsunami de 2004 (D’autres vies que la mienne 2009), biographie (Limonov 2011), naissance de la religion chrétienne (Le Royaume 2014), sa propre dépression (Yoga 2020).
Il est également journaliste et publie des reportages au long cours (voyage en Géorgie, chronique judiciaire du procès des attentats de novembre 2015).
Il est enfin scénariste pour plusieurs films tirés soit de ses propres œuvres, soit d’autres livres (dernier en date Le Mage du Kremlin d’après le roman de Giuliano da Empoli, non encore sorti mais présenté en avant-première à la Mostra de Venise).
A lire sur Culture-Tops :
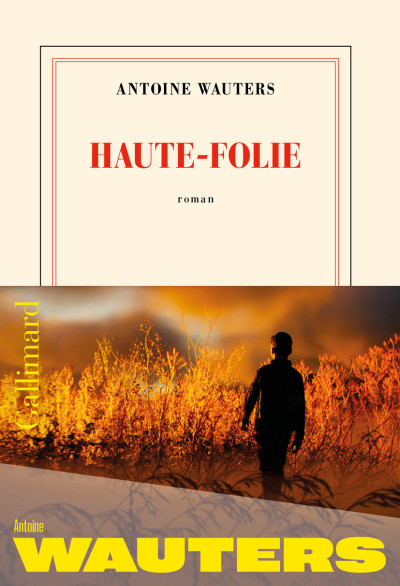
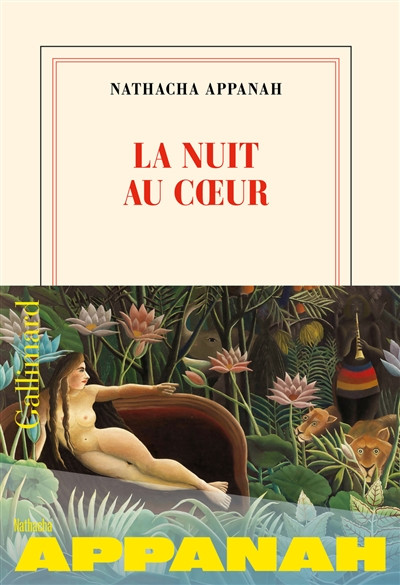
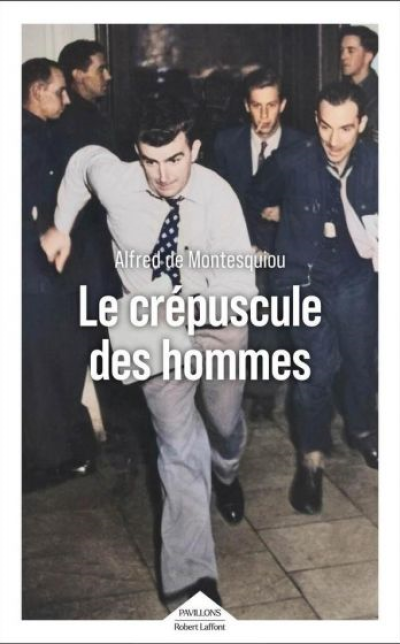
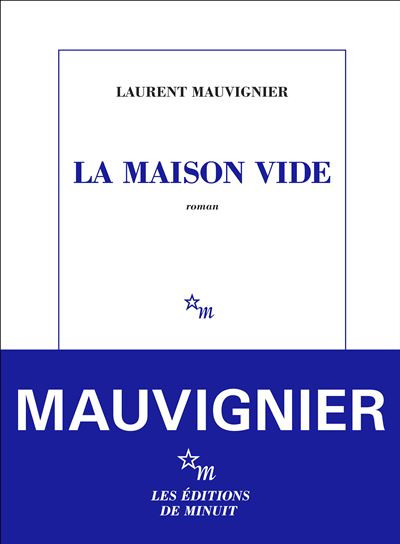
Commentaires
Sur la dernière erreur de jugement de sa mère concernant Poutine et l' invasion de l'Ukraine, Emmanuel Carrère affirmait récemment : " elle a vécu cela très mal, car elle aimait profondément la Russie. Je suis dans le brouillard disait elle. Quelque chose s'est fissurée, poursuit son fils, dans sa confiance en soi qui était grande ..."
Intervention à la librairie le Divan à Paris
Ajouter un commentaire